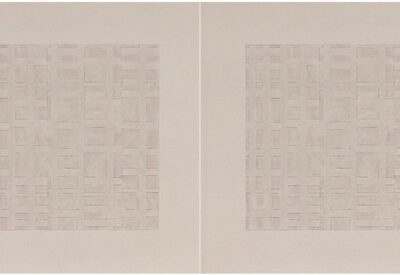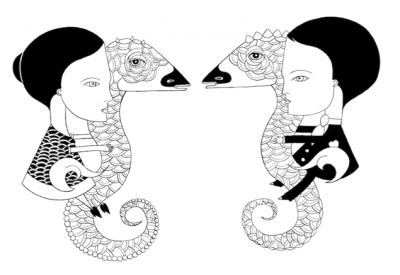PROMENADE AVEC LAURENT LE BON

ENTRETIEN GUILLAUME DE SARDES
Conservateur général du patrimoine, président du Musée national Picasso, Laurent Le Bon a été le commissaire de l’exposition Jardins au Grand Palais (mars-juillet 2017). Avant celle-ci, il en avait conçu d’autres qui ont fait date, comme Dada au Centre Pompidou (2005), parfois polémique (Jeff Koons en 2008 et Takashi Murakami en 2010 au château de Versailles), mais qui sont toutes empreintes d’un dandysme érudit. Qu’on se souvienne à cet égard de l’exposition Vides : une rétrospective (2009), donnant à voir neuf salles vides comme autant d’échos aux vernissages d’Yves Klein, John Cage, Stanley Brouwn, Maria Eichhorn, etc., où aucune œuvre n’était présentée ! L’exposition Jardins a été l’occasion d’interroger ce conservateur novateur sur sa conception de son métier : un entretien, donc, sur l’art et la manière.

Ce qui frappe d’abord est la grande place que vous accordez à la littérature dans votre exposition en découpant celle-ci en « chapitres » et en la jalonnant de citations d’écrivains de toutes époques. Le jardin, le parc, seraient-ils un motif littéraire par excellence ?
Il y a dans le jardin une dimension fictionnelle qui explique que les écrivains s’y soient si souvent intéressés. Aussi est-il naturel que la métaphore littéraire sous-tende l’exposition, et ce de plusieurs manières. D’abord, beaucoup des œuvres présentées partagent avec les livres une dimension narrative. Ensuite, la structure même de l’exposition fait signe vers le livre : ses quinze parties sont définies par un mot accompagné d’une citation. J’ai pensé qu’une telle juxtaposition mots-citations aurait une plus grande force d’évocation que des textes de salle classiques. Enfin, toute exposition est accompagnée d’un catalogue, auquel nous avons apporté un soin tout particulier.
Cette dialectique entre le livre et l’œuvre d’art est manifeste dès la première salle, qui présente côte à côte un exemplaire du Songe de Poliphile, un texte italien du XVe siècle, et une « peinture » (la couleur est obtenue par frottage de feuilles) sur toile de Giuseppe Penone. L’exemplaire d’époque du Songe est ouvert à une page ornée d’une gravure représentant un arbre en train de se transformer en femme, tandis que l’œuvre de l’artiste contemporain italien, Verde del bosco de 1984, représente un sous-bois d’où émerge, dans le prolongement d’un tronc, une présence symbolisée par une chemise de nuit fixée à même la toile. À cinq siècles de distance, les deux œuvres dialoguent ensemble dans un rapport d’inversion.
Je pense par ailleurs qu’un rapport souvent inaperçu mais très étroit existe entre une exposition et un livre : l’un et l’autre sont des créations de l’esprit. Le commissaire d’exposition est un créateur à part entière, même s’il travaille à partir d’œuvres créées par d’autres. Son rôle est très proche de celui d’un chef d’orchestre ou d’un réalisateur de cinéma. C’est une idée qui n’a pas encore la force de l’évidence, mais qui finira, j’en suis sûr, par s’imposer.

De la même manière que les citations que vous faites des grands auteurs sont empruntées à toute l’histoire de la littérature, de Cicéron à Aragon, les œuvres présentées couvrent une période allant de l’art antique à l’art contemporain européens. Comment résumeriez-vous l’évolution du regard posé par les artistes sur les jardins ?
Il faut d’abord préciser que l’exposition commence vraiment à partir de la Renaissance. Si la fresque issue de la Villa du bracelet d’or à Pompéi date bien de l’Antiquité, du début du premier siècle de notre ère pour être exact, elle est présente ici moins pour elle-même (sinon pour sa beauté) que comme matrice de la Renaissance. Entre cette dernière et la période contemporaine, les artistes ont abandonné les représentations fidèles du monde végétal au profit d’une exploration de tous les possibles. Il suffit pour s’en convaincre de comparer le chef-d’œuvre de Dürer, la Madone aux animaux (ca. 1503), avec les Acanthes (1953) de Matisse. Sur le dessin du premier les plantes sont représentées avec une telle exactitude qu’un botaniste peut les reconnaître, alors que sur le collage de Matisse elles sont presque abstraites.
L’exposition couvre une période de plus d’un demi-millénaire, ce qui explique qu’elle se limite géographiquement à l’Europe. Sans quoi l’entreprise aurait été impossible, compte tenu de l’espace relativement réduit dont je disposais au Grand Palais : 1000 m2. Je ne souhaitais pas non plus doublonner l’exposition de l’IMA, Jardins d’Orient, qui s’est tenue l’année dernière. Dans ce cadre chronologique et spatial défini, j’ai voulu que les œuvres dialoguent entre elles. C’est pourquoi elles ne sont pas présentées de manière chronologique, mais plutôt en fonction des rapports formels ou thématiques qu’elles entretiennent entre elles. L’impression de « touffu » créée par ce parti pris est un clin d’œil à l’idée même d’une nature luxuriante. Le parcours de l’exposition s’apparente à une déambulation dans un jardin avec ses moments de bosquets, de plans d’eau et de grandes perspectives.


Selon Michel Foucault, « le jardin c’est, depuis le fond de l’Antiquité, une sorte d’hétérotopie heureuse et universalisante ». Trouvez-vous que cette idée soit juste ?
Foucault a eu en 1967 cette intuition que je trouve remarquable, car il s’agit bien de cela : le jardin est un « cadrage », un espace délimité pour être dans un ailleurs. Un ailleurs tantôt plus ordonné que le monde, comme dans les jardins de Versailles, tantôt plus poétique et mystérieux, comme dans ceux de Bomarzo. Mais en tous cas un lieu autre.

En empruntant à Horace Walpole, auteur anglais du XVIIIe siècle, le néologisme de « jardiniste » (formé d’après les mots « jardinier » et « artiste ») vous élevez le jardinage même au rang des Beaux-Arts. Cela traduit-il chez vous un goût pour les arts négligés, les arts mineurs ?
Les jardiniers eux-mêmes refusent de se désigner comme des artistes. Pourtant il me semble que leurs réalisations relèvent de l’art. Le recours au terme de « jardiniste » est une manière de résoudre cette contradiction. L’art du jardin me paraît avoir sa place dans un musée. C’est aussi le cas de la bande dessinée, des arts numériques et bien sûr du cinéma. Hélas, il existe des résistances. On dit du cinéma qu’il est l’art du XXe siècle, mais peu d’expositions lui sont consacrées. Par exemple, si l’exposition Hergé, que j’ai organisée en 2006 au Centre Pompidou, était pour moi une évidence, elle avait été accueillie froidement par certains de mes collègues. Elle ne s’est d’ailleurs pas tenue dans le musée proprement dit, mais dans le forum. C’est-à-dire à la marge, ce qui est révélateur de la place qu’on croit devoir lui assigner dans le champ de l’art. Pourtant, il me semble que le meilleur de la créativité s’exprime aujourd’hui à travers les arts dits mineurs.

Dans quelle mesure cette exposition Jardins relève-t-elle d’une approche renouvelée du commissariat d’exposition ?
Après trente ans passés à réaliser des expositions, en faire une pour en faire une de plus ne m’intéresse pas. J’essaye d’apporter un regard nouveau sur ce que peut être un sujet d’exposition. Ma démarche a quelque chose de duchampien, en ce qu’elle questionne les limites de l’art. J’essaye de les rendre moins étroites.