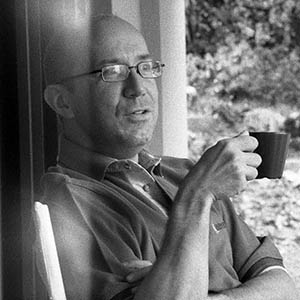CONTRE-CULTURES À LA MAISON ROUGE

PAR ALAIN RAUWEL
Que peut-il penser de l’exposition qu’il visite, ce jeune homme qui a dû naître vers 1995 et qui promène dans les salles de la Maison rouge ses baskets et sa casquette ? S’il est curieux (ce qui est probable, car autrement que ferait-il là ?), il a peut-être vu Belle dormant et découvert avec surprise qu’Adolfo Arrieta était déjà une idole pour happy few il y a quarante ans. Il sait forcément la teinte brunâtre et l’odeur nauséabonde de la vie publique contemporaine, et le procès d’une police qui mutile et qui tue (Mesrine, 1979) ne peut que lui parler, tout comme ce titre des mythiques éditions Champs libres : La politique, ceux qui en vivent, ceux qui en crèvent. Peut-être aussi, à certains moments, éprouve-t-il cette grande passion de Roland Barthes, saisie par Philippe Morillon au Palace, en 1978 : l’ennui…
Pour nous qui, hélas, n’avons plus vingt ans, pas une once d’ennui dans la belle et riche exposition conçue par Guillaume Désanges et François Piron. L’idée est en tous points excellente de documenter la grande époque contre-culturelle que fut l’après-68, de dresser « une cartographie subjective des postures minoritaires ». La chronologie 1969-1989 se comprend et a le mérite de recourir à des bornes symboliques, de « 69 année érotique » à la chute du Mur. Elle peut aussi se discuter, dans la mesure où la France n’a pas vraiment connu de ventennio rosso. Le printemps fut plus court, suivi non de l’été que l’on pouvait espérer, mais d’une imprévisible glaciation dont nous ne sommes pas encore sortis. Dès les premiers morts des années sida, au début de la décennie 1980, le vent mauvais avait commencé à souffler.
La mise en espace et en images de la Maison rouge est intelligente. Paradoxalement, ce ne sont pas les oeuvres monumentales attirant tous les regards (« Le Putain inconnu » de Journiac, « Au nom du père » de Raymonde Arcier, le cycle des Malassis…) qui sont les plus intéressantes. Les golden seventies furent en effet une décennie d’expérimentations infiniment plus que d’accomplissements. Ce qui fascine, alors, est d’entrer dans l’anti-laboratoire et les contre-archives, bien plus que de suivre les cimaises d’une exposition d’art traditionnelle. Il est paradoxal, bien sûr, de mettre en vitrines bien closes, sous la surveillance de cerbères, la substance d’une révolte contre les principes mêmes de conservation et de police. Les visiteurs de 2017, bien sages, ne jouent toutefois pas les perturbateurs, comme à « l’expo Pompidou » de 1972…
Au-delà des innombrables journaux et revues plus ou moins polycopiés qui ont fait circuler l’esprit d’insubordination et d’invention (du Torchon brule, « journal menstruel », au célèbre Hara-Kiri de novembre 1970), c’est un plaisir de retrouver au gré des sections des artistes et des acteurs de la vie intellectuelle et militante dont les mots et les images n’ont pas cessé de nous accompagner : Klossowski, Molinier, Guy Hocquenghem, Copi, Pierre & Gilles… On n’aurait peut-être pas pensé qu’on relirait un jour avec admiration les proclamations électorales du candidat Coluche, à commencer par son « Adresse aux enfants » : « vos parents sont des cons, n’acceptez pas l’hérédité » !
Au bout d’un parcours copieux, occupant tout un mur, s’impose une grande série de Kiki Picasso (Christian Chapiron) qui reprend sous un angle délibérément subjectif la chronologie documentaire qui ouvrait la visite. Toutes les contradictions d’une époque y éclatent, entre une intensité de couleurs très hippie et une violence omniprésente. Un Giscard jovial joue les stars devant une explosion atomique, et l’hideuse guillotine se dresse face aux tuyaux flambant neufs de Beaubourg. Impossible de rester indifférent, et c’est partie gagnée pour les organisateurs, qui entendaient « réveiller les consciences et les désirs aujourd’hui ».
Exposition à la Maison rouge, 10 boulevard de la Bastille, Paris, jusqu’au 21 mai 2017