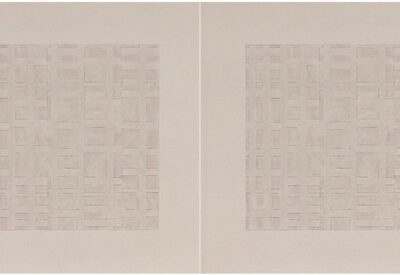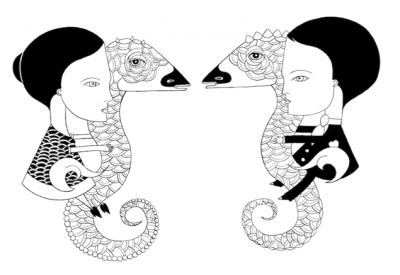JÉRÔME LAGARRIGUE, LA PUISSANCE DU GESTE

ENTRETIEN : LAURE MODESTI
À huit ans, concentré sur ses esquisses de requin, Jérôme Lagarrigue le sait déjà. L’art sera sa vie. Lagarrigue grandit à Paris et passe ses étés à New York. Il est déjà artiste et citoyen du monde, héritier des deux univers légués par ses parents : une mère noire américaine de Harlem, écrivain, et un père blanc, français, illustrateur. Il quitte la France à 19 ans pour entreprendre des études d’art à la Rhode Island School of Design.
Portrait de l’artiste par Jonathan Mannion, 2016
Lagarrigue fait partie de cette nouvelle génération de « maîtres », représentée à Paris par des artistes comme Philippe Pasqua, Craig Hannah ou Alex Kanevsky, qui gouvernent si bien les codes classiques du dessin qu’ils doivent savoir s’en détacher pour mieux sublimer les visages et les corps de leurs modèles. Pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2005, Lagarrigue a exposé à Paris, Miami, San Francisco, New York et à Londres où l’un de ses portraits trône à la National Portrait Gallery. Il a aussi flirté avec les arts urbains, ce qui lui a donné le goût des ambitions et des formats plus grands que nature. D’ailleurs un jour, il reviendra peut-être rendre hommage aux boulevards parisiens. Rien n’est exclu, il y pense. Entretien avec un authentique talent, amoureux de la création, de l’humain et de ses contradictions.
Pour vous, qu’est-ce qu’un portrait aujourd’hui ?
Je vois le portrait contemporain comme étant tout le contraire de ce qu’il fut dans le passé, à savoir souvent figé et statutaire. Dans mes portraits, je mets en scène des personnages de tous les jours et je leur rends hommage.
Le visage en dit long sur l’expérience et la vie humaine. On y trouve souvent de la mélancolie, de la confrontation, de la poésie. Sa construction est le fruit de toutes ces influences. Dans mes portraits, je mets en place une direction et le spectateur fait le reste. Il faut « ouvrir » une toile : laisser de l’espace pour que le spectateur soit libre d’écrire l’histoire. Il est inutile de tout montrer, tout peindre.
Je choisis mes modèles de manière très instinctive et émotive, sur un regard, un mot, une connexion. Généralement ce sont des personnes que je connais un peu. C’est une opportunité de partager avec le spectateur un parti-pris sur une personne.
The Colossus, huile sur lin, 2016.
Et qu’en est-il de votre muse, Shaun Ross ?
Ma rencontre avec Shaun était tout à fait inattendue. C’était un matin à Miami, devant mon hôtel à South Beach. Il avait une présence hors du commun. Cela m’a interpellé. Je suis allé le voir, je lui ai expliqué que j’étais peintre. Il a accepté d’être pris photo. J’ai alors pris plusieurs mois avant de passer à l’acte et de faire un portrait de lui. Je ne savais pas qu’il était un modèle très en vogue… Je lui ai même souvent dit que si je l’avais su, je ne l’aurais jamais choisi !
Shaun est loin d’être parfait physiquement mais il est magnétique, extraordinairement photogénique et possède une grâce étonnante. Il représente les contradictions qui m’interpellent. Pour moi, en tant que métisse, c’est un sujet important : peindre des gens que l’on ne voit pas souvent dans la peinture actuelle et dont l’identité est difficilement définissable. Un noir albinos en dit long sur les préjugés et sur les contradictions du concept de race, autant que sur la fragilité de l’appartenance à un groupe plutôt qu’un autre.
Son of Sun, huile sur lin, 2014
Parlez-nous justement de votre intérêt pour les contradictions, les paradoxes, voire pour la confrontation ?
J’ai une forte attirance pour la collision, la rencontre et le choc sur la toile entre les matériaux ou les corps. J’ai beaucoup travaillé sur le thème du combat, de la boxe. Je pense que cela est naturellement lié à mon histoire, cela fait partie de moi. Je suis le fruit de la rencontre entre deux mondes et deux cultures. J’ai été exposé à deux climats différents toute ma vie.
Dans les collisions, il y a parfois de la violence mais aussi une interaction et une poésie. Je travaille d’ailleurs une série sur les émeutes. Celles de 2005 en France m’avaient visuellement beaucoup marqué. Je ne suis pas un émeutier, je ne mène pas de combat politique. Mais je suis intrigué par cette confrontation et ses ressorts picturaux.
Quels sont les autres sujets qui vous touchent en tant que peintre ?
J’ai une fascination pour les yeux. J’ai commencé à explorer cela lorsque j’étais à Rome à la Villa Médicis, séjour dont je garde un souvenir libérateur. Il est formidable pour un artiste de ne pas avoir à se soucier de sa situation financière, et de seulement se préoccuper de l’avancement de ses capacités artistiques !
Les yeux sont les points d’exclamation d’une expression. Ils sont aussi le chemin qui suggère l’intime, l’histoire d’une personne. Ils sont le passage vers l’âme et l’humanité. Techniquement, il est très difficile de rendre compte de cette sphère et de ses volumes. Mais les yeux sont magnifiques à peindre.
Anne, huile sur lin, 2015
Vous avez dit qu’il y a une nécessité à exprimer quelque chose qui ne peut être dite avec les mots… de quoi s’agit-il ?
La peinture, c’est langage que je parle, ce n’est pas un monde séparé. Il y a une magie, un dialogue qui émane d’une œuvre, que seul le geste de la peinture peut exprimer. Chaque touche, chaque mélange sur la palette reflète un moment précis du processus créatif. C’est l’acte de peindre qui m’intéresse : de la nudité de la toile, jusqu’à la matière.
Je ne suis pas un peintre conceptuel, ni ne tiens à avoir de posture politique. Le plus important pour moi est d’exprimer la vie, le mouvement, le moment. Si l’on reste photographiquement fidèle, on fige la réalité et l’on bloque l’expérience. J’ai toujours eu une faculté à reproduire le réel mais l’objectif n’est pas là. Il faut savoir dépasser sa zone de confort et abandonner l’idée de perfection. C’est une partie intrinsèque du processus de création. Il faut aussi savoir s’arrêter pour ne pas figer et affaiblir l’impact d’une image. Je ne veux pas raconter une histoire linéaire et donner la direction à suivre. J’évite le narratif. Je veux que le spectateur ressente mon désir de création et que cela provoque en lui une réaction. Francis Bacon, l’un des artistes que j’admire le plus, savait créer cela, entre la figuration et l’abstraction. Je me souviendrai toujours d’une rétrospective à Beaubourg un été lorsque j’étais étudiant. J’ai vu des gens se mettre dans des états incroyables… ils hurlaient, souriaient, riaient, se mettaient en colère, ou encore pleuraient. Les tableaux provoquaient sur eux une décharge électrique. C’était extraordinaire.
Red Haze Revisited, huile sur lin, 2012
Et vos autoportraits, que disent-ils de vous ?
Je suis un visage comme un autre, et parfois je le trouve intéressant. Il n’y a pas de message particulier. C’est une présence que j’ai au monde, à moi-même. Quand je revois un portait de moi, comme Red Haze revisited, je ne trouve pas de mégalomanie, ni de flatterie. Au contraire même.
Souvent, cette envie de me peindre provient d’un accident. C’est une photo prise à un moment donné, une atmosphère que je trouve intéressante, notamment avec cette lumière rouge qui a inspiré la série. Il s’agit peut-être d’une manière pour moi-même de documenter mon évolution et de voir comment je parviens à me déconstruire.
Vous utilisez beaucoup la photo et la vidéo. Comment la technologie fait-elle bouger la peinture ?
L’impact de la technologie est splendide, tant qu’elle ne nous rend pas esclave. Elle multiplie les choix, les possibilités, mais l’exactitude photographique est juste un point de départ, une rampe de lancement. Avec le temps, je deviens de moins en moins fidèle au document de base. La photographie, plus précisément l’objectif du photographe, a considérablement influencé ma perspective sur l’image. Comme lors d’une mise au point, j’aime me concentrer sur un détail dont le contour et l’extérieur deviennent progressivement flous. Ce traitement photographique permet de mettre en valeur un élément et en fait disparaître d’autres.
Vous avez enseigné pendant de longues années, que retenez-vous de cette expérience de transmission ?
J’ai commencé à enseigner très jeune, trop jeune, c’était très intimidant. J’avais 22 ans et je n’étais pas prêt. Mais j’ai appris à aimer ce rôle lorsque j’ai compris que je pouvais aider les étudiants et qu’il s’agissant d’une collaboration. Je pouvais être leur ami plus que leur professeur. Nous étions tous en mission et nous avions des choses à apprendre les uns des autres. Et ils m’ont en effet beaucoup appris ! J’ai tenté de leur transmettre la discipline, notamment dans la technique. Il faut voir cela comme un échauffement, un entrainement. J’avais appris cela de mon père et de mon parcours. Il n’y a pas de miracle, l’image intéressante et le geste qui transmet l’intensité sont toujours le fruit de beaucoup de travail.
Jérôme Lagarrigue est representé par la galerie Waltman, 74 rue Mazarine, 75006 Paris, France ; 2233 N.W. 2nd Avenue Miami, Florida, USA.