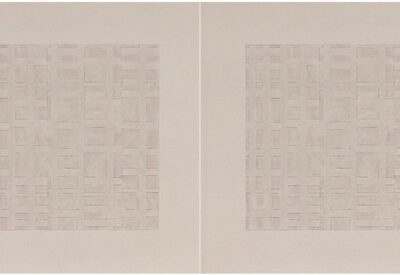RENCONTRE AVEC GASPARD NOEL, LE « BON SAUVAGE »

PRÉSENTATION FRANÇOIS CROISSY
ENTRETIEN LOUISE BACQUET

Alors que bon nombre de photographes se plaisent et complaisent à l’exploration d’un monde intime bien clos, à l’image de la chambre calfeutrée de liège de Proust, Gaspard Noel fait délibérément le choix de ce que Michel Tournier appelait l’extime : des « images du dehors », comme Duras ou Ernaux ont pu préconiser une « écriture du dehors ». Il photographie d’immenses paysages, souvent lointains et volontiers extrêmes – steppes, déserts, glaciers, etc. Mais il ne joue pas pour autant la nature contre l’humain ; ses paysages sont habités. Parfois on y repère aisément la figure, parfois il faut la chercher un moment, parfois encore elle prolifère de façon inquiétante, se dédoublant ou se décuplant. Figure toujours identique pourtant, puisque Gaspard Noel ne photographie jamais que lui-même, la plupart du temps dans une nudité de « bon sauvage », à mille lieues de tout érotisme. Ses mises en scène s’accompagnent de titres sonores, solennels ou ironiques, qui traduisent avant tout un émerveillement face à l’immensité ; ils sont aussi l’écho d’une démarche longuement mûrie et réfléchie. Rien de primesautier en effet dans les images de Gaspard Noel. Peu de photographes ont un projet aussi précis, et peu l’explicitent aussi volontiers, avec une généreuse volubilité. Il revient ici sur sa démarche singulière.
Gaspard Noel, comment êtes-vous venu à la photographie ?
Comme il est requis à la base de tout bon mythe fondateur, mes parents ont chacun posé une condition à leur union. « Nous aurons des enfants », dit ma mère. « Nous voyagerons », dit mon père. Et ainsi fut fait. À chaque vacance scolaire, de ma naissance jusqu’à mes dix-huit ans, mes parents, mon frère et moi sommes partis découvrir une nouvelle partie du monde. Mon père est grand amateur de photographie. Il avait toujours son appareil sur lui et parfois, mon frère et moi avions le droit de gâcher quelques précieuses portions de pellicules. Jusqu’à ce que nous recevions chacun un petit boitier. J’avais 12 ans, c’était la veille d’un voyage au Kenya. Trois jours plus tard, je prenais officiellement ma première photographie, une dont je suis très fier aujourd’hui encore. Je l’intitulais sobrement : « cadavre en décomposition d’une girafe malade ».
Parmi tous les genres possibles, pourquoi avoir choisi celui de l’autoportrait ?
Mon père prenait des paysages depuis trente ans. Mon frère avait un « œil », et la main sûre. En comparaison, mes images étaient floues, bizarrement cadrées et mal exposées. Pour me consoler, peut-être, ma famille me chargea de documenter la « vie du groupe », une mission inratable et par conséquent vaguement infâmante, à laquelle je pris pourtant goût. Très rapidement, je passai du vol d’instants réels à vouloir mettre les miens en scène dans des configurations artificielles qui correspondraient à mon sens esthétique bourgeonnant. Mais eux avaient autre chose à faire que poser : ils voyageaient. Alors j’ai coincé mon appareil entre deux cailloux et j’ai commencé à me photographier, moi. J’avais dix-sept ans. Pendant que mon frère et mon père capturaient des rouleaux majestueux de vagues turquoise, que ma mère lisait de la poésie assise les cheveux au vent sur un rocher mitoyen, je m’immortalisais en capitaine naufragé contemplant pensivement la mer déchaînée.
Comment articulez-vous autoportrait et paysage ?
Je ne les articule pas, je les rive ! Tout part de là. Pas de moi, pas de l’homme, pas de la Terre. Mais de l’homme sur Terre ! Il faut bien dire « autoportrait », car c’est mon corps qui apparaît sur les photographies, mais ce n’est pas moi que je prends, c’est un être humain. Celui en lequel j’ai confiance, celui que je crois idéal : l’inoffensif, l’observateur, la présence inopportune, respectueuse dans son arrogance infinie, mais contenue, de vouloir valoir. Ce que j’aime, ce que j’essaye de photographier, c’est la douce absurdité du point singulier qui voudrait, sans malice, que l’espace infini le remarque. C’est la puissance et la beauté extraordinaires que représente et que contient le simple fait d’exister. Et par cette sensation délicieuse de consistance inhérente à l’homme sur Terre, ce que j’enjoins à considérer, c’est l’idée de satiété.
Vous vous photographiez nu : pourquoi ce choix ?
Il y a tant de raisons qui s’entrecroisent. La Terre que j’aime s’offre à nous complètement nue et cette sincérité, je veux la percevoir et lui rendre. Face à nos modes de vie presque totalement détachés de notre environnement naturel, je veux rappeler que nous sommes nés pour et par lui et que l’espace sauvage est avant tout notre foyer, un lieu de liberté où se succèdent épreuves et moments de joie. Il y a bien sûr dans cette image de l’homme nu se tenant debout dans une vaste étendue dégagée une métaphore à peine voilée de la vie idéale.


Quel est votre rapport aux images des autres ?
Je n’en ai pas vraiment. Je connais peu le monde de la photographie. J’admire ceux qui parviennent à capter des instants si beaux ou si terribles qu’ils semblent avoir été mis en scène. Salgado est toujours le premier nom qui me vient en tête. Mais mes inspirations esthétiques sont bien plus souvent littéraires, dessinées ou musicales.
Vous avez, je crois, un modus operandi plutôt complexe ?
Je photographie peu souvent. J’emmagasine les sensations et les idées que m’inspirent ma vie personnelle ainsi que celles du monde réel et des mondes fictifs que je dévore jusqu’à ce que naisse le désir, voire le besoin, de les sortir de moi, souvent au cours d’un voyage de deux semaines à un mois pendant lequel je vis exclusivement pour photographier. Je pars, seul, dans un pays qui excite mon imagination et chasse sans discontinuer, jusqu’à épuisement, des paysages qui offriraient un réceptacle compatible avec les visions qui m’habitent. Dès que je ressens la moindre adéquation, je me mets au travail. Je prends mes photographies comme David Hockney peint ses tableaux, par fractions. Mon appareil sur un trépied, je quadrille le paysage et le décompose en une cinquantaine d’images en moyenne. Puis je lance le retardateur et vais m’y placer, parfois à plusieurs reprises. Plus tard, chez moi, je recompose le puzzle sur ordinateur et m’échine à réunifier sans qu’il n’y paraisse rien ce que j’ai moi-même divisé. Vient ensuite l’analyse de cette collision intuitive entre l’état d’esprit que j’ai cultivé pendant des mois et un pan de planète. J’en extrais mes titres.


Sur quelle série travaillez-vous aujourd’hui ?
Je viens de finir ma dernière série, « Futilités », pour laquelle je suis parti en Islande pendant trois semaines en septembre dernier dans l’idée de photographier le concept de « résistance ». Sept mois à travailler sans répit pour reformer 100 images à partir des 15 000 photographies prises sur place. Quinze d’entre elles seront exposées à l’hôtel Marriott Renaissance Paris Vendôme 5*, du 1er avril au 31 mai, dans le cadre de PARISArtistes# Hors les murs. Vous y êtes tous les bienvenus !