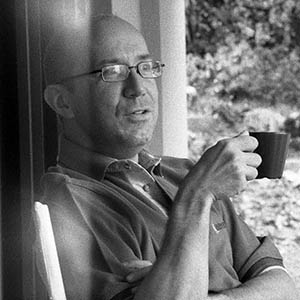JUSTE AVANT L’ENVOL

TEXTE ALAIN RAUWEL
Bientôt la Maison rouge va s’envoler, et il ne restera au bord du bassin de l’Arsenal qu’un vide propre à aiguiser notre nostalgie. Rien n’était plus logique pour la Fondation d’Antoine de Galbert que de tirer sa révérence en consacrant sa dernière exposition à «L’envol». Comme beaucoup de ses aînées, l’exposition est une belle réussite. À la fois très unifiée autour d’un propos réfléchi et rassemblant des oeuvres très diverses, elle offre à la curiosité et à la rêverie du visiteur un aliment substantiel.
La diversité des formes, des « arts premiers » à la création contemporaine, est mise au service de cette aspiration aussi ancienne que l’humain à braver les lois de la pesanteur. Avec toute la finesse qui s’imposait, les concepteurs de l’exposition trouvent les racines du désir d’envol dans les traditions religieuses ou mystiques, illustrées par exemple par une belle oeuvre d’Heinrich Nüsslein. La séquence initiale le suggère avec humour en montrant la scène de La dolce vita où un Christ de bronze est promené en hélicoptère au-dessus de Rome, attirant le regard des gamins, des ouvriers et des nymphettes. Les ésotérismes les plus divers, dans la mesure où ils ont eu recours à l’image, sont présents aussi : extatiques et spiritistes, ufologues et soucoupistes, ingénieurs fous… C’est la section « Mauvais genre » de « L’envol ».
Pour ceux qui, avec Morand, ont pour devise « rien que la terre », l’activité réglée du corps suffit à creuser le désir – avec l’appoint, le cas échéant, de ces « aliments blancs » qu’interrogeait déjà l’exposition « Sous influences » en 2013. Très haut, les funambules marchent dans le ciel. Les plongeurs ornent l’air de leurs arabesques, comme les photographes se sont plu à le saisir dès l’avant-guerre – mais la tradition continue, et l’on aurait bien vu aux cimaises le portrait que David Hockney a tracé de Tom Daley, jeune et étonnant virtuose des arts aquatiques. Bien sûr, les vedettes sont ici les danseurs : Loïe Fuller fait virevolter ses robes aux allures d’ailes, et Nijinski prouve qu’il est des humains moins soumis que le commun aux nécessités de la gravitation ; à Gisèle on eût toutefois préféré le Spectre de la rose, ce ballet de 1911 se terminant par le plus extraordinaire grand jeté de l’histoire de la danse.
Le vol est-il un jeu d’enfant ? Sans doute Henry Darger le pensait-il, dont l’exposition montre une prodigieuse frise colorée. Les auteurs de BD le croient aussi, comme le prouve une délicieuse planche de Little Nemo. Mais le sommet est atteint, à tous points de vue, par Méliès ; une copie d’une netteté exceptionnelle du Voyage dans la lune est projetée, et ces douze minutes de pur génie viennent rappeler comment, il y a presque 120 ans, un précurseur avait deviné tous les pouvoirs du cinéma – de même que Marey, à la génération précédente, avait joué en visionnaire sur les ressources de la photographie.
Il ne faudrait pas, toutefois, que la puissante séduction des pièces les plus anciennes donne l’idée que le début du XXe siècle est favorisé à la Maison rouge. Photos, objets, installations conduisent l’itinéraire jusqu’à aujourd’hui. La dimension ironique et désacralisatrice souvent présente dans les images contemporaines nuance de ce point de vue ce qu’il pouvait y avoir d’idéalisme à d’autres moments de la modernité. La conclusion du parcours est indubitablement à chercher dans « La sorcière » de Pierre Joseph : nous dirons simplement que tout s’y termine mal, entre farce et tragédie – une performance ayant doublé, à l’ouverture de l’exposition, le constat de l’image. Mais l’aventure de la Maison rouge, elle, se termine très bien, avec la légèreté qui sied aux histoires élégantes.