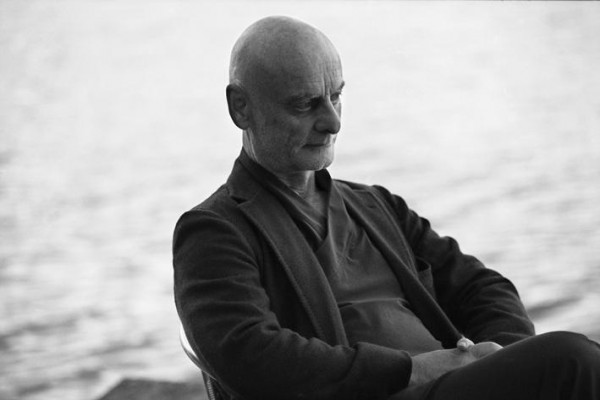ULI SIGG, LE PREMIER COLLECTIONNEUR D’ART CONTEMPORAIN CHINOIS

TEXTE LILIANE DELWASSE
PHOTOGRAPHIE GUILLAUME DE SARDES
Deux jardiniers s’affairent sur les pelouses et ratissent soigneusement les allées du parc. La lumière irisée d’un soleil d’automne entoure la propriété d’un halo doré. Les bords du lac, les prés à l’entour respirent une sérénité tout helvétique. Le palazzo d’Uli Sigg s’élève au milieu de l’île de Mauensee, sur un emplacement très ancien, un lieu de culte préhistorique où les Habsbourg avaient élevé un château en 1604. « Lorsque j’effectuais mon service militaire, j’avais découvert lors d’un exercice cet endroit exceptionnel, habité en été depuis 1930 par une vieille dame qui l’avait laissé dans une grande rusticité, sans eau ni électricité. Quand j’ai appris des années plus tard que le domaine était à vendre, je n’ai pas hésité. »
Sitôt les portes du domaine entr’ouvertes, on pénètre dans une autre île, plus mystérieuse celle-là : l’art contemporain chinois. Les codes ne sont pas aisés à décrypter. Un grand buste de marbre sans tête fait face au lac. Dans un petit pavillon en bois au fond du jardin, on se heurte à une foule étrange : vingt-cinq statues d’hommes au fou rire figé, une installation de Yue Minjun. « Détritus », un surprenant monument en marbre fait de soixante portes et fenêtres entassées, toutes différentes, orne, si l’on peut dire, un coin de pelouse.
On croise dans l’entrée de la maison une sculpture en silicone rose due à Zhang Jianjun, imitant un rocher de jardin chinois. Des jarres néolithiques recouvertes de peinture acrylique d’un côté, un bureau et une élégante bibliothèque de l’autre, signés par Ai Weiwei, l’artiste arrêté en 2011 et gardé au secret durant 81 jours, occupe l’angle d’un salon et meuble le bureau du propriétaire des lieux. Des statuettes de femmes sans tête, en porcelaine, jambes écartées, s’offrent sans pudeur dans une des salles de bain. Des jarres coréennes en savon parsèment la salle de cinéma, des tableaux faits de textile rebrodé sont accrochés dans une des salles à manger ; un arbre en bois ciré signé Feng Mengbo trône dans un des salons. Une toile au monogramme Vuitton recouvre le mur d’une chambre. Des coquilles d’œufs cassés où se nichent des crânes et des squelettes minuscules en position fœtale occupent un palier. La montée d’escalier héberge de curieux portraits d’ancêtres, au visage flou et sans regard. Un univers troublant dont les significations enchevêtrées s’entrevoient plus qu’elles ne s’imposent.
Encore étudiant, Uli Sigg était déjà passionné par l’art contemporain. L’Allemagne avait sa préférence. Ce juriste, diplômé de l’Université de Zurich, après quelques années de journalisme, aurait pu rester toute sa vie un paisible cadre supérieur de l’entreprise d’ascenseurs Schindler si, en 1979, la Chine, jusqu’alors enfermée derrière un hermétique rideau de fer, n’avait décidé de pratiquer la politique de la porte ouverte à l’Occident. Une délégation de Chinois visite Schindler pour découvrir une technologie inconnue d’eux. Uli Sigg est préposé aux relations internationales. C’est tout naturellement lui qui se rend dans l’empire du Milieu et négocie la première joint-venture jamais signée entre l’Europe et la Chine. Il précise : « J’étais vraiment un pionnier, le modèle n’existait pas, je l’ai inventé ; depuis lors, plus d’un million de joint ventures ont été signées. » Les voyages se succèdent durant les deux années que durent les négociations. Pourtant, il se rend compte que sa connaissance de la Chine se limite à un angle étroit, celui des hommes d’affaires, des échanges économiques, et que la réalité chinoise, l’immense, la fascinante réalité chinoise dans sa diversité lui reste inconnue. « J’ai voulu découvrir l’art local, mais mon œil occidental ne le trouvait pas intéressant, pas innovant. C’était une fade copie de l’art de l’Ouest et rien ne m’a plu. » Cependant, il avait pénétré le milieu de l’art, noué des contacts fructueux avec les artistes et s’était fait des amis.
Des années plus tard, le gouvernement suisse lui offre le poste très convoité d’ambassadeur, à lui, le businessman qui ne faisait pas partie du sérail. Mais c’était incontestablement le meilleur connaisseur de cette terra incognita qui en effrayait plus d’un. « Je suis resté quatre ans en poste. La Corée et la Mongolie faisaient également partie de ma zone de représentation. C’est là que j’ai commencé à acheter les œuvres des artistes chinois. Deux raisons à cela. La première est que l’art évoluait, se développait avec la société et devenait très intéressant. L’autre, c’est que j’ai décidé d’agir non plus comme un amateur, un collectionneur qui achète ce qui lui plaît, mais comme une institution, mettant mon goût personnel de côté pour privilégier la dimension sociologique des œuvres. J’ai décidé de créer à travers cette collection de deux mille deux cents œuvres, un document sur la Chine telle que personne ne la connaît. Ma collection se veut avant tout une source d’information, un miroir de ce que les artistes voient et vivent à un moment donné, une photographie de la Chine à partir des années 70 jusqu’à nos jours. Cela, personne ne le faisait, ni les Occidentaux, ni les Chinois. Les Chinois n’avaient accès jusqu’alors qu’à l’art traditionnel, figé, le fameux shanshui qui ne reflétait plus la réalité contemporaine. »
Uli Sigg rencontre plus de mille six cents artistes ; les galeries n’existent pas là-bas. On achète directement à l’artiste. À dix-huit heures trente (horaire local du repas du soir) Monsieur l’Ambassadeur et son épouse Rita remplissent les obligations de leur charge en participant à des dîners avec les officiels chinois. À vingt heures, ils dînent à nouveau, cette fois avec leurs homologues et les hommes d’affaires occidentaux.
À vingt-trois heures, Uli Sigg commence une autre vie avec les artistes qui vivent la nuit. « J’ai grimpé des centaines d’escaliers, pénétré des dizaines de cours obscures et sordides, les artistes vivaient dans des conditions de précarité, de pauvreté incroyables. Ils n’avaient aucune information sur le système d’organisation du marché de l’art tel que nous le connaissons. Le marché pour eux, c’était moi ! Ils venaient tous me voir, amenés par le bouche à oreille. J’achetais des œuvres qui valaient quelques dizaines, quelques centaines de dollars tout au plus. Aujourd’hui, les prix ont explosé, et les zéros se sont multipliés. J’étais considéré là-bas comme un fou, le seul fou qui s’intéressait à l’art contemporain ! Maintenant j’ai acquis une célébrité nationale dans le monde de l’art. »
En 1999, il organise dans le cadre de la Biennale de Venise la première exposition d’art chinois hors des frontières et fait ouvrir l’Arsenal pour l’occasion. La reconnaissance est venue. À l’occasion des trente ans de l’ouverture, les Chinois ont réalisé une série de films de 50 minutes chacun, en hommage aux personnalités étrangères qui ont le plus contribué à l’ouverture et œuvré pour la découverte réciproque. Le premier est consacré au président Chirac et le deuxième à Uli Sigg. En 2010, ce dernier est nommé commissaire général du Pavillon suisse à l’exposition universelle de Shanghai. « J’ai conçu dès le début le projet d’offrir cette collection à la Chine pour permettre à la population de connaître son art, d’apprécier cette incroyable énergie, cette profondeur bouleversante qui irrigue l’art contemporain chinois. De leur rendre ce qui leur appartient.» Il a fait une donation de mille quatre cent cinquante pièces au M+, le futur musée de Hong Kong, le premier musée sur cette période. Et qui sera visité, espère-t-il, par un public international. Il ouvrira en 2017, après avoir nécessité un investissement de trois milliards de dollars. Le complexe culturel comprendra également un Opéra. « Que les Chinois s’approprient enfin leur culture ! L’art traditionnel chinois est fait de beauté et d’harmonie, l’art contemporain au contraire bouscule et provoque. Il est temps qu’ils y aient accès. » Uli Sigg résume sa vie : « Mon ultime objet d’études et de passion, c’est la Chine. C’est ce qui a motivé et transcendé toute mon existence. À chaque voyage, j’ai le sentiment très intime, très profond, de retourner vraiment chez moi. »