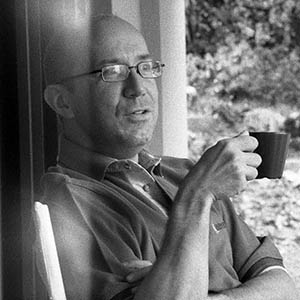PATRICK MAURIÈS, UN INTÉRIEUR D’AMATEUR

ENTRETIEN ALAIN RAUWEL
PHOTOGRAPHIE GUILLAUME DE SARDES
Dans l’appartement parisien de Patrick Mauriès, il faut conquérir de haute lutte une place pour s’installer. Livres, tableaux, dessins, objets les plus divers semblent régner en maîtres et il faut se glisser parmi eux avec mille précautions. Nous avons rendu visite à l’un des écrivains et éditeurs les plus talentueux et les plus discrets – les plus affables aussi – de notre temps, et nous l’avons interrogé sur son rapport à cette inépuisable source de rêverie qu’est son intérieur.
– Puisque nous nous rencontrons chez vous, parmi tous les objets et les livres qui vous entourent, on ne peut s’empêcher de vous demander si vous considérez votre cadre de vie comme une œuvre, au même titre que vos ouvrages.
Une œuvre, peut-être pas, au sens où j’ai connu des maisons qui étaient véritablement des œuvres, comme celles de Buzzi, de Zeri, de Praz… Une construction, pour ne pas dire une installation, oui, sans doute. Il me semble qu’il y a deux types de personnes : celles qui ont besoin, pour ainsi dire congénitalement, aveuglément, de baliser leur espace, et celles pour lesquelles c’est indifférent, qui ne voient pas ce qui les entoure. J’imagine que la majorité des gens se situe plutôt de ce côté là, et qu’ils trouvent insignifiant ce souci, mais je dois avouer que ce sont eux qui constituent plutôt pour moi une énigme. Adolescent déjà, à douze, treize ans, il me fallait tapisser les murs de ma chambre d’images, d’objets, de photos, de jouets… Je n’ai jamais vécu dans un espace neutre. De ce point de vue, j’étais spontanément de plain-pied avec Federico Zeri, qui nageait dans un océan de livres, de sculptures et d’objets, dans une opulence qu’avait rendue possible son commerce, à tous les sens du terme, avec Paul Getty. Et je placerais à l’extrême opposé, parmi les personnalités hors normes qu’il m’a été donné de rencontrer, l’appartement, ou plutôt le lieu de Roland Barthes, qui se contentait d’ordonner un coin de pièce avec des tréteaux, une simple chaise, de vieilles boîtes de cigares et des caisses en bois qui servaient d’espaces de classement ou de rangement… Ce n’était pas en même temps un espace indifférent, mais un cadre mûrement pensé, très structuré (pour ne pas « distraire », je crois : la distraction est le charme puissant et dangereux des intérieurs « pleins ») ; il le reconstituait même en vacances. Et le résultat était, bizarrement, très esthétique.
– Cet appartement, c’est aussi, d’une certaine façon, un résumé de votre biographie.
On pourrait dire que j’ai passé ma vie à « retrouver » et rencontrer des artistes, peintres ou écrivains dont l’œuvre me semblait être restée en souffrance, ou du moins en mal de reconnaissance. Il m’en reste pas mal de reliques, de témoignages qui sont la trace et le souvenir de ce qui a immanquablement donné lieu à l’amitié. La charge mémorielle et affective de ces objets est pour moi unique, intacte. Ils sont la marque d’un assentiment et d’un dialogue. J’ai ainsi continuellement sous les yeux, si je puis dire, le fil de ma vie, ce qui pourrait angoisser certains, je le comprends. Mais de mon point de vue, c’est ce qui justifie, de façon ultime, tout projet de collection : cartographier des rencontres, qu’elles soient réelles ou virtuelles, et vivre dans ce réseau d’affects, de passions. Et il est vrai que j’aimerais qu’il reste, sous une forme ou sous une autre, quelque chose de ce théâtre de la mémoire ou de l’esprit, que je puisse en livrer au moins quelques clefs… Où et comment, je ne sais trop. Autant dire aussi que le côté financier, monétaire, de la chose n’a pour moi aucun intérêt, quand bien même certaines de ces œuvres – celles de Line Vautrin, par exemple – ont pris depuis une valeur considérable, qui les met hors de ma portée. Je dois avouer que je suis absolument choqué, qui plus est, par les sommes colossales engagées aujourd’hui dans le marché de l’art. Je répète toujours ce mot de Zeri, qui s’y entendait pourtant en affaires, selon lequel il devrait y avoir une limite fixée au prix des œuvres d’art (pas plus de 10 000 francs, disait-il à l’époque !). J’aime bien cette vision, même si elle ressort plutôt de l’utopie platonicienne… La seule solution face à cette forme d’inflation folle est de ruser avec le marché, de profiter des incohérences du système, des « trous d’air » des ventes par exemple, où l’on oriente le regard sur ce qui est censé « valoir la peine », alors que l’œuvre d’à côté peut être tout aussi intéressante au fond, et bien plus accessible. Je pense en outre que toute collection doit coûter : elle est le fruit d’une recherche, d’un désir longuement poursuivi, et l’on y frôle toujours la limite… Ses limites financières en particulier. Il n’est pas plus mal, il est peut-être même souhaitable, de construire une collection en ayant des moyens limités, comme les miens, et de parvenir à construire quelque chose dans ce cadre là.
– Plusieurs de vos rencontres avec des artistes ont été liées à votre travail d’éditeur.
Toutes même, puisque mon ressort, c’est au fond l’exercice d’admiration. Et ses admirations, on a toujours envie de les faire partager. De même pour les collections d’ailleurs : je suis toujours assez heurté par le fait que les non-collectionneurs – j’allais dire les laïcs – placent toujours la collection, le goût des objets, du côté de l’amassement, de l’accumulation (« mais comment faites-vous pour faire rentrer tout ça ? quand allez-vous vous arrêter ? » etc.). C’est un contresens total : un collectionneur n’a jamais l’idée d’amasser ou d’accumuler. Chaque objet est pour lui unique : c’est un, plus un, plus un… Et tout cela ne s’ajoute pas. C’est un peu une mentalité de primitif. Évidemment, cela finit par faire nombre, mais ce n’est qu’une conséquence annexe, un effet indésirable, comme on le dit pour les médicaments (ou les drogues). Il faut faire avec. Parce qu’autant que l’objet, compte sa place dans la collection. Un objet qui n’a pas trouvé sa place n’existe pas vraiment, il est incomplet, bancal. Il faut donc résoudre le problème, mais cela ne vient qu’en un second temps. Le premier, c’est le foudroiement, la sidération de la trouvaille, de l’objet incomparable et unique. Peu importe la conséquence, c’est-à-dire d’être ensuite encombré. Il en est de même, je dirais, pour mon travail d’éditeur (et sans doute d’écrivain) : il s’agit avant tout de faire partager un enthousiasme, de remettre en lumière un livre ou une œuvre restée dans l’ombre, d’offrir à la (re)considération. De convier à visiter une partie de votre bibliothèque, comme les possesseurs de cabinets de curiosités le faisaient avec leurs lieux pour les voyageurs de passage…
– Maniérisme, cabinets de curiosité, etc. : vous avez été précurseur en bien des domaines, vous intéressant parmi les premiers à des champs devenus ensuite « à la mode ».
Mon amie Michèle Hechter, dans ses grands moments d’exégèse analytique, avait coutume de me moquer en disant que j’étais au fond un grand hystérique : toujours prêt à prévenir et à prévoir le désir du maître (en l’occurrence de l’époque) sans qu’il ne m’en reste grand chose… Et il est vrai qu’en me retournant sur mon parcours, il m’est très, très souvent arrivé de m’intéresser à des œuvres, des thèmes ou des artistes quelques années avant qu’ils ne changent de statut ou n’occupent le devant de la scène. Regardez ce qu’il y avait sur Pontormo en 1973, ou sur Vivant Denon en 1980… Cela dit, tout ça n’a pas grande importance. Rien ne sert, vous le savez, d’être en avance, il faut surtout arriver au bon moment, et pour cela, je suis beaucoup moins doué.
– À côté des peintres, vous avez constamment défendu les « arts décoratifs ».
Ce doit être quelque chose d’oedipien, mais j’ai toujours été fasciné par les créations des années 35/55 ; il y a là très souvent un mélange de pauvreté, à cause de la pénurie des années de guerre, et de baroque qui me touche beaucoup ; ce fut aussi le moment où s’affirma une sensibilité – « néo-romantique » justement, ou néo-baroque, historiciste, ce que l’on veut, parallèle à celle du credo « moderniste » qui a ensuite causé tellement de ravages. J’ai passé ma jeunesse dans des collections de Plaisir de France, L’œil ou Connaissance des arts. J’étais pour ainsi dire familier de Jean Charles Moreux, d’André Arbus, de Fornasetti, Bérard, Gruau ou Line Vautrin depuis toujours. Aussi n’ai-je eu de cesse, quand l’occasion m’en a été fournie, d’aller trouver les créateurs de cette période, lorsqu’ils vivaient encore, pour leur rendre l’hommage qu’ils auraient dû recevoir depuis longtemps. Cela fut l’un de mes grands motifs d’enthousiasme, et d’écriture. Comme en ce qui concerne le maniérisme, j’ai toujours considéré les arts dits « décoratifs » comme des formes de création à part entière, qu’il fallait lire dans leur logique propre, et non comme des arts « mineurs » ou secondaires. C’est un combat qui n’est jamais gagné, qu’il faut toujours poursuivre avec acharnement, bien que nombre de ces artistes aient largement depuis gagné en dignité, si je puis dire.
– Le cinéma a-t-il joué un rôle dans la construction de votre esthétique ?
Je ne sais pas si c’est un effet d’optique lié à l’âge, mais je crois pouvoir affirmer qu’il y a eu dans le cinéma italien un moment d’une extraordinaire intensité dans les années 70, quand Fellini, Visconti, Antonioni ou Pasolini ont sorti comme en rafale une série de films magistraux : Roma, Le Satyricon, Ludwig, Théorème, La chute des Dieux, Ludwig… Ce fut pour moi une suite de chocs en termes de rythme, d’imagerie, de vision – au sens presque hallucinatoire du terme – qui ne s’est jamais reproduit pour moi à ce degré. Il y a eu ensuite la vague « opératique » d’un certain cinéma allemand autour de Schroeter, Fassbinder ou Syberberg, mais c’était plus expérimental, plus confidentiel . Et je ne suis pas sûr qu’il se soit produit ensuite une autre conjonction comparable (de même, pour parler d’un tout autre domaine, dans l’écriture de l’essai en France dans les années suivantes). Il est compréhensible après tout qu’il y ait des temps forts et des temps morts dans l’histoire des arts – comme peut-être celui que nous traversons. Peut-être ne s’agit-il encore une fois que d’un effet de perspective lié à ma situation dans le temps, et que le futur ou des gens mieux informés me démentiront. J’ai été en tous cas profondément marqué par ce que l’on pourra appeler l’ « esthétisme » de ces années là, et par ce qu’il pouvait avoir alors de véritablement scandaleux. Ce qui m’éloigne (avec des exceptions bien sûr, comme Tim Burton ou d’autres) de la culture dominante aujourd’hui, c’est, tant en littérature qu’au cinéma, une façon d’appuyer le trait, d’en rajouter dans la glauquerie, une violence aussi codée qu’obligée, l’affirmation de soi, l’exaltation du médiocre, un naturalisme honteux… Comme s’il fallait déverser dans le « spectacle » au sens large tout ce que l’on se refuse à affronter dans la vie. Et ce romantisme controuvé qui fait que bien des œuvres me semblent profiter, si l’on veut, du destin tragique de leur auteur. On n’a jamais connu autant de « destins tragiques » qu’aujourd’hui : Guibert, Koltès, Dustan, ou même Pasolini sous ce biais… Seraient-ils ce qu’il sont sans cette aura ? Il me semble en tous cas légitime de se poser la question.
– S’il vous fallait pour finir désigner quelques figures du monde de l’art qui vous ont marqué, qui évoqueriez-vous ?
Parmi les artistes, je citerais Pierre Lesieur, qui était tellement hors système, avec pourtant son cercle d’amateurs passionnés, souvent fortunés, qui l’ont à la fois protégé et pour ainsi dire dérobé aux yeux du public. J’avais un attachement profond à son égard. Il était déjà très âgé quand nous nous sommes connus, et je crois lui avoir apporté un peu de la reconnaissance qu’il attendait. C’était un homme qui, à plus de quatre-vingts ans, ne savait passer ses journées qu’à peindre, qui avait encore une joie presque enfantine à découvrir et faire surgir des formes, des accords, un certain trait, qui s’émerveillait que ceci lui « arrive » encore. Du côté des esprits supérieurs, et des grands excentriques, Zeri était assurément un homme hors du commun, doté d’un œil et d’une culture hors pair, un grand comédien aussi, qui ne pouvait que fasciner. Et j’ajouterais à cela un illustre inconnu : Stéphane Deschamps, antiquaire rue Guénégaud, qui fut l’un des premiers à s’intéresser aux arts décoratifs des années 1930 et à avoir pour clients, dans une boutique qui n’avait rien de bien luxueux, aussi bien Barbara Streisand qu’Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld ou Andy Warhol. Archétype pour moi de ce que devrait être un antiquaire, il n’était marchand que par nécessité. C’était un doux rêveur, un personnage un peu lunaire, qui avait fréquenté, en spectateur à la fois captivé et discret, les grandes figures de la vie et des salons parisiens depuis les années cinquante (Louise de Vilmorin en particulier, sur laquelle il n’était jamais à court d’anecdotes, et pour laquelle il a réveillé mon intérêt). Comme chez Pierre Lesieur, il y avait en lui une capacité d’émerveillement continue, un mélange de sophistication et d’ingénuité que je continue de trouver infiniment émouvant.