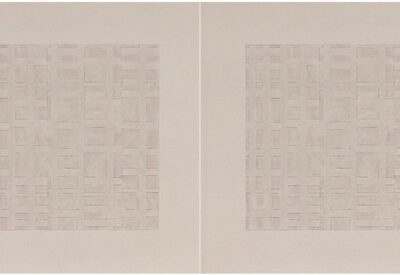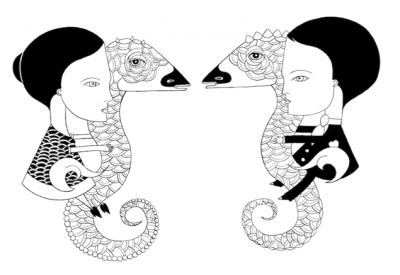FABRICE GUÉNIER, UNE MÉMOIRE FRAGMENTÉE

ENTRETIEN ET PORTRAIT GUILLAUME DE SARDES
Fabrice Guénier, auteur de deux romans chez Gallimard (Les saintes et Ann), avait publié en 1998 un « journal d’hiver » dans lequel il évoquait, en mots et en images, les souvenirs que fait resurgir une rupture. Les éditions Filigrane donnent aujourd’hui une nouvelle vie à cette évocation délicate et forte. Nous avons eu envie de rencontrer l’auteur…

Pourriez-vous nous expliquer le contexte dans lequel vous avez réalisé ces photographies ?
Suite à une rupture, que j’avais envie de documenter, en ayant le temps et le besoin. C’était le journal d’un abandon, la chronique d’une ère glaciaire ; une façon d’employer ce temps vide aussi pour gratter cet état. On enterre souvent trop vite ce qu’on croit avoir perdu et du coup on enterre des choses vivantes avec. On peut vivre en pensant qu’il y a un message et qu’il ne faut surtout pas le rater, mais on peut vivre aussi en pensant que tout est message et qu’il faut tout prendre, même si on a l’impression souvent que la vie nous a confondu avec quelqu’un d’autre. Même dans une prison, il faut être présent. Je voulais faire un de ces livres qui en savent plus que nous sur ce qu’on vit.

Vous êtes écrivain et votre livre de photographies est scandé par de brèves notes poétiques. Comment fonctionne ce rapport texte-image ?
J’ai toujours aimé les fragments : les images volées pas forcément voulues, les phrases qui arrivent par hasard. Je ne crois pas trop à l’hypnose, un peu totalitaire, du visuel pur, sans contexte. Je ne crois pas non plus à l’idée du texte autre qu’inspiré, donc à trous, parcellaire, coq à l’âne et intuitif. L’écriture doit être recueillie, comme un peu tout ce qu’on crée sans doute. J’avais beaucoup de notes éparses dans des carnets, pas mal d’images plus ou moins anciennes, sur des planches contact amoureusement gardées. L’idée du journal permettait de lier tout ça, de réunir des éléments disparates en donnant à l’ensemble un semblant de cohérence narrative, et c’était de toute façon, dans sa fabrication, une sorte de journal « d’un hiver ordinaire » (comme le disait le sous-titre de l’édition originale). Pendant une année et demie, j’ai collecté et assemblé des détails, noté trois phrases, des miettes de texte pesé au trébuchet, parcouru d’anciennes planches de négatifs ; trouvé une façon de délaver, de dissoudre ces images avec une manière particulière de les tirer : en superposant sous l’agrandisseur des couches de calque, de papier de soie sur le négatif, en virant ensuite les tirages — en utilisant le procédé chimique du virage sépia à l’envers — c’était Photoshop avant Photoshop, un travail manuel — on accroche les tirages pour qu’ils sèchent, comme une mère étend du linge sur un fil. L’idée était de faire naître sur les images l’usure qu’elles ont prise dans notre mémoire, les textes venant en écho pour dire ce que nous fait cette mémoire.

D’une manière plus générale quel rapport entretiennent vos œuvres littéraire et photographique ?
Dans les quelques articles parus sur Ann ou Les saintes, revenait souvent l’expression : « écriture photographique » et devant les images de Je crois qu’un jour, on m’a parlé de « photographies littéraires ». Ça se boucle bien. C’est la même source, la même envie d’exprimer des choses. On fait ça pour que des choses s’approchent. La photo (telle que je la pratique) a l’avantage d’exister parce que des choses arrivent, de nous être donnée en quelque sorte, même si ensuite il y a un travail, quelque chose préexiste. Écrire c’est surtout s’écrire. L’écriture est du temps passé dans une autre vie. Qu’on choisit. Avec qui on veut. On écrit d’abord pour ne pas être là.

Appréciez-vous particulièrement les écrivains-photographes ?
Je ne suis pas très à l’aise avec les étiquettes, les tiroirs, les boîtes. Pour moi, on écrit, on fait des photos, de la musique. Est-ce que ça fait de nous quelque chose ? On « fait » plus qu’on « est ». À l’époque, j’avais en tête Les fiancées de Saigon de Depardon, le travail de Sophie Calle, les Chambres d’Asie de Manset ou Le poids du monde de Peter Handke, l’écriture de Duras ; la photo (fameuse) de Lee Miller, aussi, en 1945 : « Lee Miller dans la baignoire d’Hitler », qui change de sens quand on lit la légende qui l’accompagne. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de livres qui accolent sur une double page l’écriture et la photographie, pour produire un troisième sens, et sans doute ne me sentant « à la hauteur » dans aucun de ces deux domaines, je me disais qu’en unissant les deux ça pourrait faire advenir quelque chose. Le premier livre de photographies que j’ai acheté, à l’adolescence, était Les demoiselles d’Hamilton, dans cet album les images étaient accompagnées d’un texte de Robbe-Grillet. Je sais qu’il est de bon ton maintenant de vouer l’un aux gémonies et de moquer l’autre, mais je pense que ça m’a durablement marqué ; le deuxième, peu de temps après, c’était Les Américains de Robert Franck ; et je pense que ça borne très exactement mes goûts en images : entre David Hamilton et Robert Franck.

Pourquoi republier ce livre aujourd’hui ?
« To begin is easy. To persist is art. » a dit Franz Körte. Dans un premier temps pour qu’il existe un peu encore, sans doute, édité par un éditeur — et non plus à compte d’auteur —, à côté des deux de chez Gallimard ; et puis, suite à cette question que vous avez posée, pour une autre raison, peut-être à peine consciente. On connaît la citation de Debord : « Tout ce qui était directement vécu s’éloigne dans une représentation. » Dans Je crois qu’un jour, je parle de bougies, de mains, de départ, de muret, de pyjama, d’eau, de parc. Ce monde disparaît pour laisser place au « virtuel », cette consolation qu’on nous laisse. On nous écarte du monde, petit pas par petit pas, innovation par innovation. Nos rencontres, nos amis, nos lettres, nos images, nos appels, nos loisirs, tout ce qui était jadis incarné n’existe plus aujourd’hui qu’intermédié par écrans interposés. Même ces mots, écrits d’abord sur une feuille de papier, seront lus sur un écran, et seulement là. L’heure digitale ne nous indique plus qu’un temps présent, une suite d’instants détachés, quand les cadrans indiquaient un espace, avec un avant et un à venir, comme dans : Je crois qu’un jour.