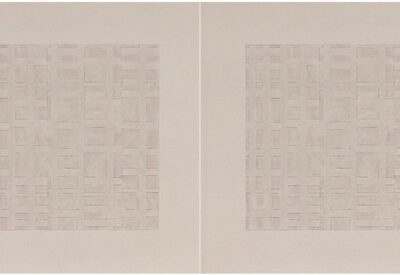BERTRAND BONELLO OU L’ÉROTISME NOIR AU CINÉMA

ENTRETIEN GUILLAUME DE SARDES
 Bertrand Bonello est l’un des cinéastes les plus originaux d’aujourd’hui. Les questions du sexe et du genre traversent toute son œuvre, déjà abondante, sans aucune complaisance mais sans concession non plus aux canons de la tolérance bourgeoise. Son dernier film, L’Apollonide, est celui qui a rencontré le plus vaste public : d’une grande beauté formelle, il est sans doute moins radical que les précédents. Les cinéphiles se souviennent du retour à l’écran de Jean-Pierre Léaud, légende vivante du cinéma français, dans Le Pornographe (2001). Ils sont encore sous le choc de ce qui est probablement à cette heure le chef-d’œuvre de Bonello, Tiresia (2003), audacieuse transposition du mythe grec dans une ville d’aujourd’hui. Mais peut-être le film le plus mystérieux, le plus intrigant, est-il ; De la guerre (2008), où une Asia Argento impériale déclare à Matthieu Amalric que « le plaisir se gagne comme on gagne une guerre »… Inutile de dire que l’on attend avec impatience de voir ce que fera Bonello d’une autre figure mythique de la modernité, ce Saint Laurent dont le tournage est en cours.
Bertrand Bonello est l’un des cinéastes les plus originaux d’aujourd’hui. Les questions du sexe et du genre traversent toute son œuvre, déjà abondante, sans aucune complaisance mais sans concession non plus aux canons de la tolérance bourgeoise. Son dernier film, L’Apollonide, est celui qui a rencontré le plus vaste public : d’une grande beauté formelle, il est sans doute moins radical que les précédents. Les cinéphiles se souviennent du retour à l’écran de Jean-Pierre Léaud, légende vivante du cinéma français, dans Le Pornographe (2001). Ils sont encore sous le choc de ce qui est probablement à cette heure le chef-d’œuvre de Bonello, Tiresia (2003), audacieuse transposition du mythe grec dans une ville d’aujourd’hui. Mais peut-être le film le plus mystérieux, le plus intrigant, est-il ; De la guerre (2008), où une Asia Argento impériale déclare à Matthieu Amalric que « le plaisir se gagne comme on gagne une guerre »… Inutile de dire que l’on attend avec impatience de voir ce que fera Bonello d’une autre figure mythique de la modernité, ce Saint Laurent dont le tournage est en cours.
Vos films, du Pornographe à L’Apollonide, paraissent sous-tendus par la question bataillienne de l’érotisme et de ses rapports avec la mort.
Ce n’est pas surprenant, parce que je tiens Georges Bataille pour le plus grand écrivain du XXe siècle. Je l’ai beaucoup lu. Son approche de l’érotisme m’intéresse, car d’un point de vue cinématographique la cohabitation du plaisir et de la mort est d’une force évidente.
C’est par ailleurs un auteur au style musical, donc inspirant pour un réalisateur. C’est une conversation que j’ai eue avec mon ami Jean-Jacques Schuhl : de la même manière que la musique suscite beaucoup d’images, une prose musicale est cinématographique.
Ces images sont-elles le point de départ de vos films ?
Oui, tout part d’elles. De deux ou trois images qui sont des scènes fondatrices, au sens où ce sont elles qui me donnent envie de faire le film. Dans L’Apollonide, c’étaient les larmes de sperme et la femme qui rit. Dans Tiresia, la crevaison des yeux avec des ciseaux.
Jusqu’à quel point cet intérêt pour l’érotisme noir vous engage-t-il ?
Cette sexualité bataillienne n’est pas la mienne. Elle ne m’intéresse que dans la mesure où elle se rattache à l’idée de décadence. C’est cette dernière qui est au cœur de mon cinéma, jusque dans les détails, comme ce pétale qui tombe dans L’Apollonide, alors qu’une des prostituées passe devant un bouquet de roses. Yves Saint Laurent, dont je prépare le biopic, est de ce point de vue un personnage emblématique. Il s’est détruit petit. Il aimait frayer avec le danger, avec la mort, comme Pasolini. Cet attrait pour l’abîme est un beau thème pour le cinéma.
Il faut dire que réussir un film solaire est ce qu’il y a de plus dur. Cela nécessite sans doute d’être plus âgé, de s’être débarrassé de certaines idées adolescentes… Rohmer a réussi ça avec son cycle des Contes des quatre saisons.
Vous avez cité Pasolini et maintenant Rohmer. Quels sont les réalisateurs que vous aimez ?
Ces deux-là, évidemment. Grâce à Rohmer, j’ai compris que le classicisme peut être plus radical que le radicalisme de convention contemporain. Quant à Pasolini, qui m’a inspiré mon premier court-métrage en 1996, il est, avec Bresson, mon cinéaste favori. D’autres réalisateurs, comme Hitchcock, Bunuel ou Cronenberg me plaisent également et m’ont influencé par leur vision fétichisée de l’érotisme. Hitchcock par exemple est passionnant : par sa manière de découper, il parvient à fétichiser une clef ou un verre de lait ! Son cinéma est transgressif, mais de manière subtile, indirecte. Vertigo, si l’on y pense, est un film nécrophile. Il m’a tant intéressé que j’en ai tiré mon propre scénario : c’est la même histoire, mais du point de vue de Madeleine. Je ne l’ai pas tourné pour des questions de droits. Mais je ne désespère pas de le faire un jour.
De nombreuses scènes dans vos propres films relèvent du fétichisme. La plus forte est peut-être celle, dans L’Apollonide, où le personnage de Léa, à la demande d’un client, prend l’apparence d’une poupée automate. L’homme passe derrière elle et la manipule, la dispose à sa convenance avant de la prendre.
Le fétichisme est l’accès que j’ai trouvé pour ne pas filmer des scènes de sexe banales et répétitives. En outre, il renvoie à un imaginaire raffiné qui était celui des maisons closes. Raffiné, mais dur, ce que cette scène montre bien : entre Simon et Léa le rapport de domination est très fort, plus fort même que dans un rapport sexuel violent. Car la poupée est la négation de la femme.
La scène tire une grande partie de son intensité du jeu d’Adèle Haenel, qui parvient à ne pas ciller. Ses grands yeux fixes, vides, m’avaient déjà impressionné pendant les essais, au moment du casting. J’ai su immédiatement que ce serait elle. Le jour du tournage, il y eut un heureux imprévu : Adèle portait sous sa robe anglaise des bottines dont le cuir craquait à chaque mouvement, comme les rouages d’une mécanique rudimentaire. Je n’ai eu qu’à accentuer ces bruits au mixage. C’est la magie du son direct !
Cette scène rappelle le film de Joël Seria, Marie-poupée (1976). Dans ce dernier, Claude, un collectionneur de poupées anciennes, épouse une très jeune femme à qui il demande de rester inerte pendant qu’il l’habille, la dispose et la baigne… Ce film vous a-t-il inspiré ?
Non, je ne le connais pas. Mais je ne suis pas surpris que d’autres se soient intéressés aux poupées : ce sont des objets glaçants… Dans mon court-métrage Cindy : The Doll is mine (2005), le long plan d’ouverture montrait toute une collection de poupées.
Ce court-métrage est une fiction inspirée de Cindy Sherman et on peut voir dans votre appartement des œuvres de César, d’Hantaï, etc. Quel est votre rapport à l’art contemporain ?
J’ai grandi dans une famille qui s’y intéressait beaucoup. À Nice, mes parents recevaient de grands galeristes comme Leo Castelli, Yvon Lambert, Daniel Templon. César venait souvent en voisin. Je me souviens de lui préparant des pâtes ! À l’époque, les choses étaient simples : les artistes échangeaient entre eux des œuvres, et les amateurs achetaient selon leur goût. La financiarisation de l’art dans les années 1990 a changé tout ça. Je le regrette.