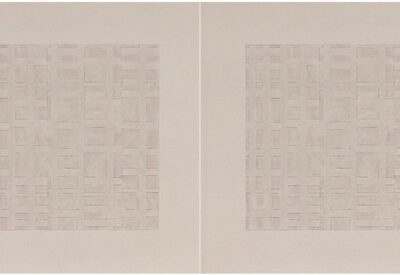CHEZ PIERRE & GILLES

TEXTE PATRICK MAURIÈS
PHOTOGRAPHIES MATHIEU FERRIER


Je doute que Pierre et Gilles, dont la curiosité est pourtant universelle, aient jamais entendu parler de Joris-Karl Huysmans, le romancier inventeur, disait le méconnu Laurent Tailhade, du «sabbat, de la messe noire et de la crème de céleri», le créateur aussi du névropathe et sulfureux Jean, du des Esseintes. Néanmoins, sans le savoir, nos deux maîtres de l’imagerie contemporaine sont de modernes des Esseintes: comme lui, ils choisissent, à une fin de siècle (les années 90), de quitter le remugle parisien pour se plonger dans l’exotisme d’une banlieue pavillonnaire; comme lui, ils n’ont guère d’égard pour toutes les formes du naturel: il n’est pas jusqu’aux feuilles luisantes de leurs plantes vertes, cultivées à la lumière électrique, qui n’aient l’air d’être vernies au polyester; comme lui, ils fuient avec application la lumière du jour, mais là où il se protégeait par de lourdes tentures et des rideaux tirés, ils aveuglent de grandes feuilles de palétuvier et de vitrages opaques la large baie qui donnerait, il est vrai, directement sur la rue. Point de jardin de plantes vénéneuses chez eux, mais un enchevêtrement de lianes de loupiotes; et deux jack-rusells électriques (succédant à un mainates, par trop jacasseur, puis à une escouade de perruches volant en liberté, et atterrissant sans crier gare) jouent ici le rôle de la pauvre tortue dont des Esseintes incrusta la carapace de pierreries, et qui n’y survécut pas.
Comme le pavillon de Fontenay derrière lequel le pâle aristocrate choisit d’abriter son spleen, rien n’annonce, de l’extérieur, le paradoxe intérieur: un immeuble à l’architecture posément brutaliste des années 60, étrange hiatus, comme le terrain envahi d’herbes folles qui lui fait face, dans la succession de petites rues proprettes qui quadrillent le village; un crépi bleu canard; un grand hall lugubre et décati qu’animent seules les paillettes sertissant amoureusement, sur une porte laquée, l’image d’un Poulbot pissant.
Le seuil franchi – d’un ancien atelier de coutellerie – se révèle être autant celui d’un parc à thèmes que d’un appartement ou d’un atelier, suite vertigineuse de décors carrelés, vernissés, incrustés de verre ou de céramique, de bars, de serres, de cellules, d’alcôves dont pas un centimètre carré n’est exempt de motifs de strass ou de paillettes, obéissant aux lois implacables de la symétrie la plus extrême: rien n’existe ici ui n’ait son reflet ou sa contre-courbe; rien non plus qui n’ouvre sur autre chose, porté par la force d’une prolifération naturelle que n’arrête aucune porte, mais que laisse fluidement se développer une succession d’arches ou d’arcades évocatrices d’un Orient que n’eût pas dédaigné, cette fois, Pierre Loti.
Cuisine mozarabe, moucharabiehs complices, chambre chinoise dont les murs laqués de rouge et les gros idéogrammes de bois dorés n’auraient pas été déplacés au Chabanais, recoins disco, bars pour boîtes à marins (autre thème sensible du lieu), déités proboscidiennes venues des Indes et immense autel à offrandes célébrant un placide bouddha thaï, le tout rythmé par une succession d’escaliers à vis ou en colimaçon qui semblent multiplier les défis à la géométrie euclidienne. Le plus secret mène incidemment à ce que les Anglais nomment dungeon (et nous basse-fosse), où se trouve l’atelier de prise de vue, avec son appareillage impressionnant, digne d’une salle de torture des films hollywoodiens ou des cintres de l’opéra baroque: nulle paillette ici, à part celles qui sont minutieusement appliquées sur les gigantesques décourtes de gaze, historiées avec une patiente de miniaturiste, qui servent d’arrière-fond à chaque portrait. Réalité tridimensionnelle de cette esthétique de l’immaculé qui s’accomplit dans l’effacement de ses auteurs, et dans une trompeuse neutralité.
On n’aurait garde d’oublier les innombrables collections qui émaillent de leurs registres multiples murs et recoins: photos autographiées de modèles fameux, qui ne dépasseraient pas une chambre d’adolescent ou les murs d’un restaurant de Montmartre, ribambelles de Pinocchio, de poupons, de peluches, de doudous, de Barbie, de G.I Joe, de Billy the gay doll, de Teletubbies qui prennent d’assaut rampes et piliers. Face à l’un des deux bars ici-bas chus d’une boîte à bardaches de la Côte d’Azur des années 50, une impressionnante rétrospective de ces artistes for boys only que cultivèrent jalousement des esthètes montherlanesques, et dont on ne reprochera pas l’ignorance au lecteur moyen: Gaston Goor, Soungouroff, Czanara ou Jean Boullet (c’est pourtant bien de leur tradition obscure que s’inspire pour une part l’art des maîtres de maison).
Gay? Cela ne se discute pas. Kitsch? Ce serait réduire à trop d’univoque cet art tendre et matois. Camp? Pas loin en tout cas de cette esthétique de la sophistication naïve, de cet art de vivre dans le décalé, de cette sensibilité de l’insaisissable, mais la question est trop complexe pour être traitée en quelques lignes. Nous voici en tout cas au royaume du bricolé et du fait main (l’art n’étant, comme l’on sait, que la forme transcendée du bricolage), de la ciselure et du serti invisible, de la récupération et du recyclage des déchets; ceux en l’occurence du bon goût et de la dérision. En cela, il faut aussi ranger Pierre et Gilles aux côtés de Frédéric Séron, boulanger de Pressoir-Prompt, qui enfermait au coeur des statues dont il peuple son jardin, coupures de journaux, tickets de métro, cartes-souvenirs et petits cailloux; du plombier couvreur Hippolyte Massé qui tapissa son pavillon des Sables-d’Olonne de coquillages et de sirènes, ou, sans même évoquer le Facteur Cheval et son domaine de Hauterives, de Raymond Isidore, employé du cimetière de Chartres, qui revêtit toutes les surfaces de son intérieur, jusqu’à la moindre chaise, d’un somptueux manteau de fonds de bouteilles, de fragments de porcelaines et d’éclats de flacons de parfum, ce qui lui valut la consécration sous le nom de Picassiette.
«Ce qu’ils choient, écrivit Breton en préface de l’admirable livre de Gilles Ehrmann où ils sont rassemblés (Les Inspirés et leurs demeures, 1962), ce qu’ils nous invitent à choyer dans leurs demeures, c’est bien véritablement ce que de toute pièce ils en ont fait.». Sans doute Pierre et Gilles ne sont-ils ni boulangers, ni plombiers, ni facteurs, ni employés de mairie (juste un petit peu de tout cela peut-être), mais leur demeure n’est pas simplement le prolongement ou l’harmonique de leur vision de la réalité, telle que la traduisent leurs oeuvres, de cette naïveté critique, et retorse, face à un monde soumis au culte de la puissance et de l’argent; c’est une oeuvre à part entière, une création réfléchie, comme l’était celle de cet autre inspiré, le cordonnier Gaston Chaissac qui proclama dans son style admirable: «J’ai beau être parvenu à brilloter avec mes brimborions qui pourtant ne doivent pas valoir un trio de brévicaudes mangeables et j’ai beau être aussi battologue que possible, on me prend volontiers pour Bachacon. Et des barguigneurs venus regarder ma peinture l’ont traitée de batifolage et moi de batifoleur»
J’image volontiers, pour revenir à mon parallèle initial, que cet autre batifoleur – désabusé- que fut le duc Jean des Esseintes, téléporté au XXIème siècle, n’eût manqué de se convertir, du culte de sainte Lydwine de Schiedam à celui de la Sylvie Vartan de miséricorde, ou d’une Sheila en extase mystique, qui sourient béatement sur les murs du salon, hypnotisées pour l’éternité par nos deux artistes brilloteurs.