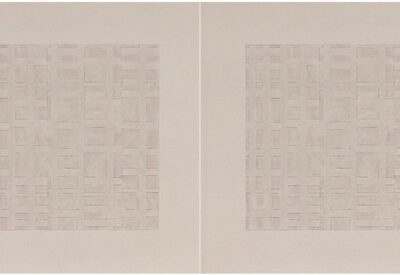LES FEMMES RÊVÉES DE SAM GUELIMI

ENTRETIEN GUILLAUME DE SARDES
Guillaume de Sardes : Vos séries photographiques dégagent une profonde impression d’unité. De l’une à l’autre, on retrouve les même thèmes et les même ambiances. Toutes semblent refléter le même monde intérieur. Pourriez-vous en définir les éléments les plus importants ?
Sam Guelimi : Ce qui m’intéresse c’est l’anti-naturel, la magie de l’artifice. Ce qu’une femme peut « évoquer », le geste qui la résume. Tout cela est sans rapport avec les stéréotypes de l’érotisme, du moins compris comme une catégorie mercantile. Si je photographie des femmes très différentes toutes s’animent d’une même façon. Toutes ont la même préciosité dans le maintien ou la pose d’une main. Le maniérisme me plaît, je ne m’en cache pas. C’est sur lui que je travaille. Les vêtements m’intéressent également. Ils déshabillent mes modèles, ils sont comme leur corps exhaussé, comme un masque rituel qui dit une vérité fatale mieux que le visage même.
Bien que j’aime la sophistication, mes photos ne sont pas retouchées ni mes modèles maquillées ou coiffées par des professionnelles. Je les prépare à poser en leur parlant de cette femme dont je rêve, celle que je souhaite leur voir incarner. Je me plais à fabriquer de faux moments volés : des « airs » qui n’appartiennent pas aux modèles, un geste qu’elles ne reproduiront peut-être jamais… En ce sens, le décor ne m’intéresse guère. J’ai fait mes premières séries dans mon bureau, sur un bout de canapé. Toujours le même. L’essentiel est que mon modèle me laisse la toucher pour disposer ses bras, ses jambes. Ce que je photographie, c’est moins une femme que son double aérien. Aérien, mais charnelle. On ne reconnaitrait pas mes modèles si on les croisait dans la rue.
Quand j’étais adolescente, j’étais timide et pas très bien dans ma peau. Avant un rendez-vous, je me disais : « si tu peux parler, ça se passera bien. » Je pensais que si mon verbe était précis et ma voix musicale alors on oublierait ce qui me déplaisait en moi… Avec mes photographies, je pense la même chose : peu importe les imperfections de la fille, ma technique limitée, la pauvreté du décor si on entend cette voix…
Il y a encore un trait commun à toutes vos photographies que vous n’avez pas évoqué : ce sont vos propres habits, bijoux et accessoires que vous prêter à vos modèles au fil des séries. Quel est le sens de cette démarche ?
Ce que je cherche chez toutes les femmes que je photographie, c’est celle qui leur préexiste à toutes, la femme dont je rêve. Appelons-la Edwarda. Une apparition dont rien n’atteste vraiment l’âge, la classe sociale, l’identité légale. J’aime cette phrase de Fitzgerald : « Sans nulle autre adresse que la nuit dont elle surgit. » C’est pourquoi je cherche à effacer tout ce qui indiquerait quelle est la vie de mes modèles, leurs goûts ou leurs occupations. Les chats ont sept vies, Edwarda a cent, a milles visages. Mais une seule garde robe. Et, si celle-ci est la mienne, c’est qu’Edwarda est issue de mon imaginaire, aussi intime qu’une empreinte digitale et aussi charnelle qu’une voix.
Une des singularités de votre travail de photographe est que ce dernier est conçu pour une revue que vous animer, dont le titre est justement Edwarda. Toutes vos séries sont faites pour elle.
C’est vrai, et j’irais même plus loin : je ne suis photographe que dans le cadre d’Edwarda. Mes clichés s’inscrivent dans la conception générale de la revue. Ils en sont une facette. Je me sens d’ailleurs moins proche de la figure classique du photographe, que de celle du savant Edison qui, dans le roman de Villiers de L’Isle-Adam, donne vie à son « Êve future », et se perçoit dès lors comme un démiurge plus que comme un scientifique. Que vous m’envisagiez comme une photographe à part entière me touche : c’est que j’ai réussis quelque chose et qu’Edwarda est « plus vraie que nature », mieux encore, qu’elle est plus naturelle que la vérité.
Fitzgerald et Villiers de L’Isle-Adam… Vous avez déjà cité deux écrivains, mais aucun photographe. Pourriez-vous préciser le rôle que tient la littérature dans vos œuvres ? Et les autres arts ?
La littérature, bien entendu, n’est pas seule à donner corps aux photographies que je prends. Mais parce que les livres m’accompagnent depuis l’enfance, on peut dire qu’ils sont l’enfance de mes images. C’est dans un second temps que d’autres arts sont venues nourrir cet univers de mots : les œuvres de cinéastes choisis, et notamment certains plans de leurs film. Il y a les jambes de Marlène Dietrich dans Le Grand alibi de Hitchcock, la démarche de Jeanne Moreau, qui passe lente, droite et belle comme un rêve de chair, de La Notte d’Antonioni à Eva de Losey. La photographie a évidemment joué un rôle. Arielle s’est faite couper les cheveux est l’un des clichés d’Helmut Newton dans laquelle je peux vivre le plus souvent, tout comme dans ceux de Guy Bourdin, de Harry Pecinotti, ou de Juergen Teller. Il me semble qu’il y règne ma température idéale. Tout cela nourrit mon imaginaire.
L’univers d’Edwarda doit pourtant moins à ces figures tutélaires qu’à celles, nouvelles et mouvantes, que font apparaître l’extra-sensibilité de Dominique Ristori, Ferdinand Gouzon, Yannick Haenel ou encore Mathieu Terence, dont les héroïnes ont rejoint mon Olympe. Avec Jefferson nous sommes parvenus à unir au sien de notre revue des genres et des disciplines différentes que nous ne voulons pas fondre ensemble mais auxquels nous voudrions donner le même air de famille : celui de la beauté, celui de l’excitation et, le plus rare de tous, celui du secret.
NB : Voir le site internet de la magnifique revue Edwarda