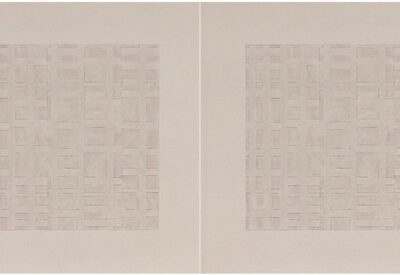NILS VON DARDEL, PEINTRE DE LA VIE ÉLÉGANTE

TEXTE MASSIMILIANO MOCCHIA DI COGGIOLA
J’ai sous les yeux un catalogue des œuvres de Nils von Dardel, un vieux catalogue français, acheté quelques euros chez un bouquiniste. En le feuilletant, on voit défiler des images bariolées : de petits bonshommes élégamment vêtus, avec de souliers de soirée et des bas colorés ; ils se couvrent le visage avec un éventail, ils s’ennuient ou se moquent les uns des autres ; ils sont pudiques et sensuels, et ils accompagent de jeunes demoiselles assez gracieuses, coiffées à la mode des années vingt, au visage doux et résigné. Les garçons, apparemment, s’amusent plus que leurs compagnes : ils jouent du tambour, font la fête, parfois maltraitent de petits chiens et des chats noirs en fêtant l’arrivée du printemps. Parfois aussi ils finissent assassinés. Est-ce là un nouveau jeu? Des paons blancs assistent à ces cérémonies sanglantes. Un romantisme enfantin transparaît dans les peintures de Dardel qui me charme et en même temps m’inquiète. Derrière ces couleurs joyeuses se cache une profondeur d’âme qui touche la mort.
« J’ai sous les yeux une série de gravures de modes commençant avec la Révolution et finissant à peu près au Consulat. Ces costumes, qui font rire bien des gens irréfléchis, présentent un charme d’une nature double, artistique et historique. Ils sont très souvent beaux et spirituellement dessinés ; mais ce qui m’importe au moins autant, et ce que je suis heureux de retrouver dans tous ou presque tous, c’est la morale et l’esthétique du temps. » Ces mots de Charles Baudelaire introduisent l’un de ses essais les plus célèbres, Le peintre de la vie moderne (1863), consacré à son ami Constantin Guys. Baudelaire a pris comme point de départ les aquarelles de Guys pour un essai qui parle de tout sauf de peinture. L’idée du poète est plus ambitieuse : faire de l’art avec des mots en décrivant des « types » parisiens, exactement comme Guys le faisait avec ses croquis. Un des chapitres fondamentaux est dédié au dandy. Le dandy de Baudelaire se pare d’habits quasi sacrés et fait de la Beauté une religion absolue qui n’admet pas d’autres lois que les siennes. Le « type » du dandy est ainsi synthétisé, pour la première fois depuis la biographie de Brummell par Barbey d’Aurevilly, parue huit ans auparavant, comme « un Hercule sans emploi ». Nils von Dardel fut un de ces personnages herculéens capables de trouver un emploi : il passa sa vie à peindre. Baudelaire faisait référence à Guys comme à une sorte de portraitiste du dandysme; il aurait pu parler de Dardel de la même façon.
Le Suédois Nils von Dardel (1888-1943), parfois plus simplement Nils Dardel (le « von » était ajouté en France pour manifester des origines aristocratiques), a su en effet mettre autant de dandysme dans son œuvre que dans sa vie. Du point de vue de l’histoire de l’art, Dardel est un cas plutôt difficile. Seulement durant un bref moment, entre 1911 et 1913, il produisit des œuvres en relation directe avec ce que peignaient les artistes autour de lui. Il donnait alors dans la peinture cubiste, démontrant qu’il avait totalement assimilé Picasso et Braque. Peu après, cependant, il prit le chemin qui le mena vers cette peinture « naïve » qu’il explora par la suite. Il ne fut pas le seul artiste suédois de sa génération à choisir le faux naïf comme solution picturale, mais il fut le seul à le faire de façon aussi systématique. Quand il comprit que le cubisme ne pouvait lui fournir une base adéquate pour développer son œuvre, il réagit en se retirant en lui-même, dans son monde ; il avait l’habitude de fuir ainsi tous les problèmes. Il se trouve que ce monde empli d’ombres et de cauchemars était aussi le monde qui l’entourait, dans lequel il devait vivre. Par délicatesse, il sentait qu’il devait le présenter comme une conte de fées, une histoire des mille et une nuits, aux couleurs gaies, aux scènes amusantes. Dardel inventa ainsi une sorte de surréalisme inversé : au lieu d’utiliser les symbolismes freudiens tant aimés par le groupe de Breton, il théatralisa ses propres obsessions. Ainsi, son surréalisme ne touche pas l’inconscient en général, les rêves des autres, les problèmes des masses. L’art de Dardel est strictement limité à son monde particulier, à ses conflits intérieurs.
Après un bref séjour à Paris, Dardel avait pris en 1910 logement à Senlis, petite ville peu éloignée de la capitale où il fréquentait les cours de Matisse ; sa peinture était encore marquée pas le néo-impressionisme. La rencontre avec le critique d’art et collectionneur allemand Wilhelm Uhde (qui tomba éperdument amoureux de lui) le marqua profondément. Uhde était de ces collectionneurs comme il n’en existe plus : il achetait l’art dans lequel il croyait, non ce que le marché conseillait ; il crut ainsi en sa femme de chambre, Séraphine Louis, peintre amateur, convaincue par lui de se vouer à l’art, avec grand succès (elle est aujourd’hui une icône de la peinture naïve). Après la recherche cubiste avec ses tons éteints, Dardel ressentit l’urgence de la couleur. Le chef-d’œuvre de la période cubiste, Rue à Senlis (1912), fut repris en 1913 avec un traitement différent.
Nonobstant ses airs de millionnaire raffiné, la situation économique de Dardel demeura instable jusqu’à sa recontre avec celui qui deviendra non seulement son mécène mais surtout son compagnon : Rolf de Maré, suédois lui aussi, du même âge que Dardel, déjà célebre pour son ambition, son patrimoine familial fabuleux et son inclination pour les jeunes talents. De Maré avait beaucoup d’argent, et l’autorité donnée par la fortune. Il était un homme d’action, grand voyageur, doté d’un rare talent pour découvrir chez les autres la créativité qui lui faisait défaut. Dardel, lui, était un garçon beau et trop sensible, pas très sûr de lui, mais doué dans le domaine de la fantaisie. En 1912, l’anné de sa rencontre avec de Maré, Dardel avait déjà appartenu à différentes « sectes » de dandys, comme le cercle du Kattgreven (le Comte des chats), une bande de jeunes dissipés à Stockholm, ou le cercle d’Héliogabale – nobles vauriens, sang bleu à flots, insolence raffinée, alcoolisme et excentricité.
Le détachement aristocratique, la morgue, la sprezzatura de Dardel ne venaient pas seulement de la classe sociale élevée à laquelle il appartenait ou des cercles saugrenus qu’il fréquentait. Depuis son enfance, il savait que son cœur n’était pas solide. Le sentiment de la mort le rendait différent : il sentait que le destin le poursuivait. L’alcool finit par devenir son ami et confident le plus intime. Rolf de Maré sut lui redonner confiance en lui-même, grâce aussi aux voyages qu’il pouvait lui offrir : Alger et Tunis, l’Espagne et Teneriffe. En 1917, les deux amis fuient l’Europe défigurée par la guerre et ils arrivent aux États-Unis, avant d’aborder au Japon. L’art japonais fut une grande découverte pour Nils, qui resta à Tokyo six mois, produisant une grande quantité de dessins et aquarelles. La relation avec de Maré donna au jeune Dardel bien plus que ce qu’il avait espéré, même si entre eux il était toujours question de disputes et réconciliations, car les deux dandys avaient leurs amants respectifs (Dardel aimait fréquenter garçons et filles), plus ou moins cachés, et ils finissaient par se retrouver sans jamais parvenir à se quitter vraiment.
Quand de Maré décida de fonder une compagnie de danse capable de rivaliser avec les Ballets Russes, Dardel suivit de près l’aventure du Théâtre des Champs-Elysées. Ce fut une occasion à ne pas rater : pour le lancement de la compagnie, en 1920, il exécuta la scénographie et les costumes de La nuit de la Saint-Jean. L’inspiration était clairement folklorique, renvoyant à la coutume des villageois suédois de danser autour d’un poteau enrubanné pour célébrer la nuit la plus courte de l’année. Exceptionnellement, il nous reste des images de ce ballet grâce au film L’Inhumaine de Marcel L’Herbier (1923). Pour de Maré et son premier danseur Jean Börlin, tous deux passionnés d’arts figuratifs, les peintres étaient les rois des Ballets Suédois. Grâce à Fernand Léger, Giorgio de Chirico, Picabia et évidemment Dardel, les Ballets Suédois parviendront à égaler voire parfois à dépasser leurs grands rivaux, les Ballets Russes, jusqu’en 1925. De Maré était aussi le propriétaire de la première revue de mode masculine digne de ce nom, Monsieur – revue des élégances dans laquelle il vantait le Théâtre des Champs-Elysées comme temple de la musique moderne, mais aussi les Ballets Suédois, grâce au portrait que Dardel fit de Börlin dans La danse siamoise (1919).
Tandis que sa relation avec de Maré prenait fin, l’artiste commença à songer à fonder une famille mais, nonobstant ses bonnes intentions, il avait vu se fermer plusieurs portes – jusqu’au moment où, en 1919, il rencontra la baronne Thora Klinckowström durant un voyage en paquebot. Il sut reconnaître dans les soins affectionnnés de Thora quelque chose de plus que la simple amitié. Le mariage eut lieu en juillet 1921 avec pour témoins Braque, Léger, Kisling, Satie et Lisa Duncan (la fille d’Isadora). Les années vingt furent prises dans le vortex de fêtes perpétuelles du premier après-guerre ; le divertissement paraît sans limites, la vie des théâtres et des cabarets est florissante, comme l’ont décrit Cocteau et surtout Maurice Sachs. Portraits et études prennent une place grandissante dans la production de Nils, avec plusieurs portraits d’amis suédois ou américains, comme Hemingway ou Pound, mais aussi Brancusi et Picabia, ou Laurencin, Baron, Crevel, Cocteau et Soupault. Les personnages de Dardel n’assistent plus, au centre de paysages hallucinés, aux pantomimes de petites créatures loufoques. Le peintre s’inscrit dans le « retour à l’ordre » typique des artistes de sa génération, amplement théorisé par Cocteau en 1926, une étape qui semble avoir exorcisé ses peurs et ses obsessions – même s’il rêvait encore aux paradis perdus de l’enfance.
Dardel obtient de plus en plus de succès auprès des critiques et devient un portraitiste à la mode. Son mariage, en revanche, est un désastre : à côté des peintures mondaines, nombreuses sont les images d’un couple qui se tourne le dos, représentation un peu naïve de la situation conjugale du peintre. La séparation était inévitable, tant les styles de vie étaient différents : Thora fréquentait les stars du cinéma, tandis que Nils se complaisait dans la haute société ou les bistrots bohêmes, entre peintres équivoques et dandies de quatre sous. Thora n’ignorait pas le goût de son mari pour les garçons et elle prit des amants : Raymond Radiguet fut un des premiers. On suppose qu’elle inspira au jeune écrivain le célèbre Diable au corps. Le divorce fut décidé en 1932, et Dardel en sortit moralement détruit. En raison de la crise économique, il fut obligé de quitter son atelier, et les commandes se firent rares. Sa santé empirait ; plusieurs attaques cardiaques firent émerger des figures macabres dans ses dessins, ainsi qu’une série de tableaux intitulés Les Croque-morts.
La générosité de de Maré et un partiel redressement financier lui permirent d’entreprendre une longue série de voyages en Afrique du Nord. Ce fut une période assez productive pour Dardel, qui passa des mois à peindre la population arabe de Tunis et Alger, donnant au moins une centaine d’aquarelles qui surprennent par leur maturité, leur style presque académique. Une exposition personnelle à Goteborg et une rétrospective à Lund furent alors de grands succès. Les sceptiques étaient vaincus, la critique unanime. On parla même de « dardelisme » mais, si l’on juge par ce qui nous reste, les dernières années de Dardel, pleines de portraits et paysages, sont à la fois plus sereines et moins riches par rapport à la production des années dix et vingt.
La guerre trouva Nils à Oslo ; il s’embarqua pour New York. Là, il retrouva Dalì, en compagnie duquel il se trouva mal, et cela lui donna l’idée de visiter l’Amérique du Sud. Son dernier point d’attache fut le Mexique (1940-1942), un pays qui suscita un nouveau sursaut de créativité. Dardel découvrait un peuple, avec une chaleur nouvelle, une humanité méconnue jusque là. Mais il ne renonça pas à ses mises en scène ambiguës. Un tableau comme L’après-midi d’un chasseur de têtes montre crocodiles et jaguars, oiseaux fantastiques et coupeurs de têtes auxquels une stylisation reprise de l’ancien art aztèque donne quelque chose d’inquiétant. Juste après sa première exposition à New York, Nils von Dardel, Parisien suédois, meurt d’arrêt cardiaque à cinquante quatre ans.
On ne peut dire que son rôle fut fondamental dans l’histoire de la peinture européenne. Révolutionner le monde de l’art ne l’intéressait pas. Il souhaitait en faire partie, connu par un petit nombre de passionnés et de mécènes. Dans son cas, ces passionnés furent nombreux, au point qu’aujourd’hui Dardel est considéré en Suède comme une sorte d’icône nationale. Pour nous, il reste une belle figure dans la brillante communauté intellectuelle européenne de la première partie du XXe siècle: fragile et tenace, plein d’esprit, spectateur de l’écroulement d’un monde qui était son monde, il disparut – heureusement pour lui, sans doute – avant qu’un tout autre monde ne se lève à l’horizon des temps.