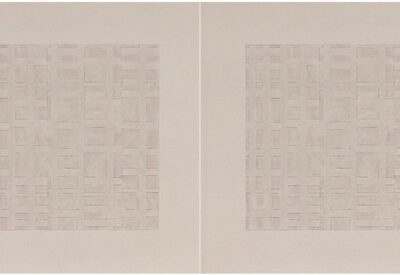ATTENTION FRAGILE. ENTRETIEN AVEC ANDRÉ S. LABARTHE

ENTRETIEN ET PHOTOGRAPHIE NICOLAS COMMENT
Critique aux premiers Cahiers du cinéma – les fameux « Cahiers jaune » initiés par André Bazin, puis créateur en 1964 (avec la femme de ce dernier, Janine) de la célèbre collection Cinéma, de notre temps, André S. Labarthe est à la fois le plus discret et plus disert héraut de la Nouvelle Vague (mouvement qu’il fut d’ailleurs l’un des premiers à annoncer dans son livre Essai sur le jeune cinéma français en 1959). Véritable témoin oculaire du cinéma de la modernité, A.S.L. n’a pas cessé d’alimenter l’histoire du 7e art d’une réflexion en perpétuelle mutation à travers la réalisation d’une série de films sur des cinéastes aussi divers que Marcel Pagnol, Samuel Fuller, Fritz Lang, Jean-Luc Godard, Alain RobbeGrillet, Alfred Hitchcock, Jean-Pierre Melville, Norman Mac Laren, Eric Rohmer, Nanni Moretti, David Cronenberg, etc. Auteur d’une cinquantaine de moyens et longs métrages et d’au moins autant d’essais télévisuels consacrés à la littérature, à la peinture ou à la danse, Labarthe est également le praticien assidu d’une écriture qu’il distille au compte-gouttes dans des ouvrages où l’aphorisme et le fragment se partagent entre pensées théoriques et intuitions poétiques. Volontiers acteur à ses heures perdues (notamment pour JeanLuc Godard), Labarthe est aussi un personnage à part entière qui apparaît régulièrement dans ses films sous les traits fictionnels de celui qu’il nomme « le type au chapeau ». L’homme n’étant donc plus à une contradiction près, je suis venu lui parler de quelques projets qu’il n’a pas réalisés, histoire de vérifier que les plus beaux films sont souvent ceux qu’on ne voit pas…
Je me suis récemment rendu compte qu’il y avait un grand absent dans la collection Cinéma, de notre temps, c’est Antonioni…
Oui, car évidemment, nous avions toujours voulu lui consacrer un film (du moins, nous l’avions filmé une fois, tandis qu’il commentait la dernière séquence de Profession Reporter à la table de montage, c’était pour l’émission « Cinéma Cinéma »)… Mais peu après, Antonioni à été victime d’une attaque cérébrale : il n’était donc plus question de faire un film sur lui. Un jour Godard m’a appelé pour me proposer de faire ce film sur Antonioni… Je lui ai donc expliqué qu’Antonioni était paralysé et que, bien qu’ayant toute sa tête, il ne pouvait absolument plus parler. Jean-Luc m’a alors répondu : « ben, on appellerait ça Les Silences d’Antonioni » ! Nous aurions peut-être pu le faire, c’est vrai… Mais le fait est que la dernière fois que j’ai vu Antonioni – à l’occasion d’une conférence avec Alain Robbe-Grillet –, j’étais tellement ému de le voir dans cet état, que je suis tombé en larmes…
Il y a aussi cet autre film impossible dont tu m’avais parlé un jour, un projet avec Hans Bellmer…
Bellmer venait de faire paraître Anatomie de l’image chez Éric Losfeld (directeur de la maison d’édition Le Terrain vague où A.S.L. avait publié son Essai sur le jeune cinéma français [ndlr]). Losfeld m’avait donné le livre de Bellmer et j’avais écrit un article dans la revue Bizarre dirigée à l’époque par Michel Laclos (qui aujourd’hui conçoit les grilles de mots croisés dans Le Figaro). Un jour que je passais à la galerie Le soleil dans la tête, rue de Vaugirard, tenue par une certaine Mme Levêque (j’étais ami avec son fils, Jean-Jacques, qui écrivait des poèmes et des textes sur la peinture), cette Mme Levêque donc me dit « Bellmer est passé et a laissé quelque chose pour vous »… Elle me remet alors Anatomie de l’image, dédicacé par Bellmer et orné d’un dessin avec son adresse. Je l’ai donc appelé et nous nous sommes vus.
Rue Mouffetard ?
Oui, rue Mouffetard. Je me souviens très bien : on traversait une cour, c’était au premier étage. Je suis entré dans une pièce sombre. Il y avait un lit à gauche, et sur ce lit une femme nue était allongée dans la pénombre… Je ne l’ai su qu’après : c’était Unica Zürn. Il y avait un grand poêle au milieu de la pièce et deux petites fenêtres. Bellmer m’a alors expliqué qu’Unica et lui se partageaient l’espace et avaient chacun sa fenêtre pour dessiner. C’était tellement sombre que je me suis demandé comment ils arrivaient à travailler. Car les deux fenêtres donnaient sur un mur, trois mètres plus loin… Comment faisaient-ils l’un et l’autre pour dessiner des choses aussi précises avec si peu de lumière ? C’est lors d’une de ces visites que nous avons évoqué l’éventualité de faire un film ensemble. Cela l’excitait beaucoup car il souhaitait voir son univers en mouvement et – déjà – en 3D.
Il connaissait bien le cinéma ?
Non, ses idées étaient surtout des idées de métamorphoses comme dans ses dessins ou bien comme pour sa fameuse Poupée où tout pouvait être interverti : on pouvait en effet modifier sa Poupée, placer la tête à la place des jambes, lui mettre quatre jambes ou quatre bras. La Poupée avait donc un rapport avec le cinéma. Car il fallait la « monter », exactement comme on monte un film… Cela dit, il ne pouvait pas non plus vraiment « métamorphoser » sa poupée. Il ne pouvait faire cela qu’en dessin. Aujourd’hui avec la 3D, l’image de synthèse, on pourrait faire ce qu’il voulait. Mais on en était encore seulement au cinéma d’animation…
Donc le projet est tombé à l’eau.
Oui… Je me souviens qu’à cette époque, il cherchait à vendre La Poupée – cher – et il n’y arrivait pas. Si bien qu’il m’a dit un jour, désespéré : « Je crois que je vais finir par la brûler. » Je lui ai alors répondu : « Prévenez-moi, parce que cela, par contre, je pourrai le filmer ! » Dieu merci, il ne l’a pas fait puisqu’elle est aujourd’hui à Beaubourg. C’était tout de même le fruit de toute une vie, cette poupée.
Est-ce à travers tes lectures de Georges Bataille que tu as découvert Bellmer ?
Non, les livres de Bataille illustrés par Bellmer étaient introuvables et inabordables. Par contre, dans les années cinquante, j’avais acheté Les Jeux de la poupée… Attends, je vais te montrer ! A.S.L. revient avec une petite pile de livres, parmi lesquels son exemplaire dédicacé d’Anatomie de l’image (Le Terrain vague, 1957), mais également : Les Jeux de la poupée (Éditions premières, 1949), Œillades ciselées en branche (Jeanne Bucher, 1939) et La Poupée (GLM, 1936).
Éric Losfeld me disait qu’en matière d’édition, Bellmer était « épouvantablement maniaque ». Quand on voit la préciosité de ces livres, on comprend, c’est absolument magnifique…
Puisque nous sommes ici dans le registre de l’érotisme, je voulais en profiter pour te poser une question que toimême tu posais à Jean-Pierre Melville dans « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, en 1959 : Quelle est la différence entre l’amour et l’érotisme ?
C’était peut-être dans la foulée de ma rencontre avec Bellmer… Cette question était dans l’air du temps à l’époque. Mais c’est une question que je ne poserais pas aujourd’hui. Je n’aime pas diviser les choses comme ça. Je ne la poserais plus. Je n’aime pas définir les choses car cela revient à les figer…
C’est pourquoi tu auras passé ton temps à essayer d’échapper aux étiquettes… Par exemple, lorsque tous tes amis des Cahiers du cinéma s’échinaient à faire leurs films (Godard, Truffaut, Chabrol, Rohmer, etc.), tu as dit quelque part, que toi, à cette époque, tu rêvais !
Oui, je n’avais pas cette folie, ni l’énergie, ni le désir d’à tout prix m’exprimer dans un long métrage. Je trouvais ça presque enfantin. Imagine un monde à l’envers où chacun aurait les moyens de faire un film… Celui quiaurait le plus d’intérêt aux yeux du monde, serait alors celui qui ne ferait pas de film. Disons que j’étais en avance sur ce monde-là ! (Rires)
Est-ce la raison pour laquelle le plus beau film du monde, pour toi, a longtemps été L’Âge d’or de Luis Buñuel ?
Oui, et cela pour la simple et bonne raison que je ne l’avais pas vu ! Il était interdit. Ce film, alors, ce n’était qu’une rumeur… Dans des revues surréalistes, ne circulaient que quelques photogrammes… C’était donc forcément pour moi le plus beau film du monde ! D’ailleurs, quand j’ai fini par le voir, j’ai eu l’impression que je le connaissais par cœur, que c’était la dixième fois que je le regardais. C’était comme si je l’avais vu, dans ma tête. Je l’avais réalisé dans ma tête avec ce que je pouvais en savoir. Et après, en me confrontant au vrai film, je m’apercevais que je l’avais bien vu. Aujourd’hui encore, lorsqu’un film de Godard sort, la rumeur me suffit et je n’ai pas besoin de le voir pour qu’il m’influence déjà…
Le fait est qu’il y a un lien très étroit entre Godard et toi…
Il y a un certain nombre de films que je n’ai pas besoin de voir pour les avoir vus. Jean-Luc, par contre, lui, y va : il va voir cinq minutes d’un film et puis il change de cinéma. En cinq minutes, il a compris le film. Cinq ou dix minutes, parfois il reste une demi-heure… Il a toujours fait ça.
Cela voudrait donc dire que pour que tu t’attelles vraiment à un film en tant que réalisateur, il ne faut surtout pas que tu l’aies déjà vu ou imaginé…
Oui, j’essaie de me surprendre lorsque je fais un film. Parce que j’ai besoin que le hasard travaille. J’ai horreur de me sentir prévu ou prévisible, attendu au tournant…
La voix de Danielle Anezin, sa compagne et monteuse, s’élève alors dans la pièce à côté : « Là-dessus, tu peux être rassuré ! ».
J’ai horreur d’écrire des scénarios. Ça ne sert à rien. Il faut un point de départ tout de même, mais le journal du jour peut être un très bon point de départ !
Tu préfères mettre en place des dispositifs pour en quelque sorte piéger le hasard…
Je n’aime pas trop le mot « dispositif ». Ou alors il faut qu’à chaque fois le dispositif soit renouvelé. Le travail préparatif d’un film est surtout pour moi un travail qui consiste à faire le vide dans sa tête. Car ce qu’on obtient par hasard est beaucoup plus fort que ce qu’on avait pensé au préalable. J’aime que l’idée surgisse le plus près possible du moment du tournage, comme captée à la source.
Finalement, ta pratique du cinéma est permanente, y compris lorsque tu ne tournes pas. C’est une manière d’être, un mode de vie…
Oui et c’est pourquoi, parfois, ce n’est même pas la peine de tourner. Si le film est trop fort en soi, c’est qu’il existe, qu’on l’a déjà vu. Faire un film, c’est le découvrir. Soit il s’agit d’une commande qui suppose donc qu’il y ait un film à l’arrivée, soit il n’y a pas de commande et on tourne sans savoir si il y aura un film au bout : c’est pourquoi je découvre parfois des choses que j’ai tournées il y a longtemps et que je décide tout à coup de les monter. Mais la plupart du temps je mets les rushes dans un coin sans même les regarder…
Le téléphone sonne. A.S.L. quitte alors la conversation et revient quelques instants plus tard coiffé d’un chapeau. Le propos se fait alors plus incisif. Je comprends qu’il vient d’enfiler sa casquette de théoricien…
Ce que je n’aime pas dans l’art, ce sont les intentions. Et qu’est-ce qu’un scénario ? c’est un faisceau d’intentions. Moi, je suis du côté du hasard contre l’intention. Le scénario est surtout fait pour trouver de l’argent car les gens, justement, ne confient pas l’argent au hasard. Il faut donc louvoyer, faire semblant de savoir ce qu’on veut. Mon problème, c’est « comment faire exister les choses ». Par exemple si on filme un verre et qu’on le projette sur un écran, nous aurons l’image du verre mais pas le verre. On peut toujours essayer de changer l’éclairage, le verre n’aura pas plus de présence… Maintenant supposons qu’au moment où on filme le verre, il tombe et se brise, alors là, nous aurons le « sentiment » que le verre existe… Trop tard ! Et si le verre n’existe qu’au moment où il se brise : ce moment-là est ce que j’appelle « la fiction ». Autrement dit, l’objet documentaire a besoin de la fiction pour exister. Il faut qu’il arrive quelque chose au verre. Et c’est peut-être pour ça que le cinéma est si violent.
Cela suppose donc que le sujet de l’œuvre (et/ou que l’œuvre ellemême) ait une certaine fragilité…
Oui, car en quelque sorte, le rôle du spectateur c’est de voler au secours de quelque chose de fragile.
Cela induit aussi que le seuil de résistance ne doit pas être trop fort. Tu ne pourrais pas appliquer ta théorie à un pavé. Car le pavé résisterait…
Mais le pavé pourrait par exemple assommer quelqu’un… Chaque objet à une zone de fragilité. On ne peut pas mettre et vouloir conserver des morceaux de sucre dans un bassin d’eau. Tout le monde est attaquable par un biais. Peut-être que l’art, c’est ça, c’est de montrer que tout est fragile, il me semble. Montrer la fragilité du monde. L’art c’est un objet qui tombe et qu’on rattrape juste au moment où il va se briser…
Dehors, c’est la nuit qui commence à tomber… Je sais que la conversation pourrait durer encore longtemps, mais il est temps de prendre congé. Un verre qui se brise, une poupée qui s’enflamme… Telles sont les premières images que j’emporte avec moi en descendant la rue Ramey vers le métro Jules Joffrin. Jusqu’à ce qu’une autre leur succède et les remplace : A.S.L. – penseur et passeur d’un cinéma encore capable de jeter des ponts entre les arts – m’apparaît alors subrepticement sous les traits d’une sorte de saint Sébastien du 7e art, percé de part en part par les flèches du surréalisme et de l’érotisme… Attention : fragile.